Matt Johnson nous a permis de republier en français son article, paru en septembre 2025 dans Persuasion1, auquel nous trouvons deux grands mérites : tout d’abord, il analyse le livre d’un excellent auteur qui s’est signalé cet été par une série d’articles dans Le Monde au sujet des Etats-Unis et des « identity politics », Thomas Chatterton Williams2 ; ensuite, il témoigne que la question du wokisme, ce mouvement qui a empoisonné la gauche pendant 10 ans et qui vient de s’effondrer sous le poids de ses propres contradictions, demande à être posée à nouveaux frais si l’on veut préserver ce qu’il a pu avoir de légitime à ses débuts. Ndlr.
L’été d’il y a cinq ans peut nous aider à expliquer – et à surmonter – la situation actuelle des États-Unis. Lors d’une session conjointe du Congrès en mars, le président Trump avait déclaré : « Notre pays ne sera plus woke. » L’administration Trump a depuis démantelé la politique de « DEI » (diversité, équité et inclusion) conduite par le gouvernement fédéral, fait pression sur les entreprises pour qu’elles fassent de même, réduit de plusieurs milliards de dollars le financement des universités – officiellement en réponse à l’antisémitisme sur les campus, mais aussi pour imposer un contrôle politique et éradiquer la «théorie critique de la race» et «l’idéologie du genre». Elle a expulsé les soldats transgenres de l’armée, et supprimé l’aide au développement au prétexte, selon les responsables de l’administration, que cette aide servirait parfois à financer des causes qu’ils jugent «woke».
À bien des égards, cette croisade anti-woke est déjà dépassée. Si l’on définit le wokisme comme une forme réductrice, prompte à la censure et autoritaire de politique identitaire se voulant un mouvement pour la « justice sociale », ce phénomène est en recul depuis longtemps. Même Christopher Rufo, peut-être le militant conservateur le plus en vue aujourd’hui et l’un des principaux architectes de l’offensive de l’administration Trump contre les universités américaines, observait récemment que le « pic du wokisme » était passé depuis quelque temps.
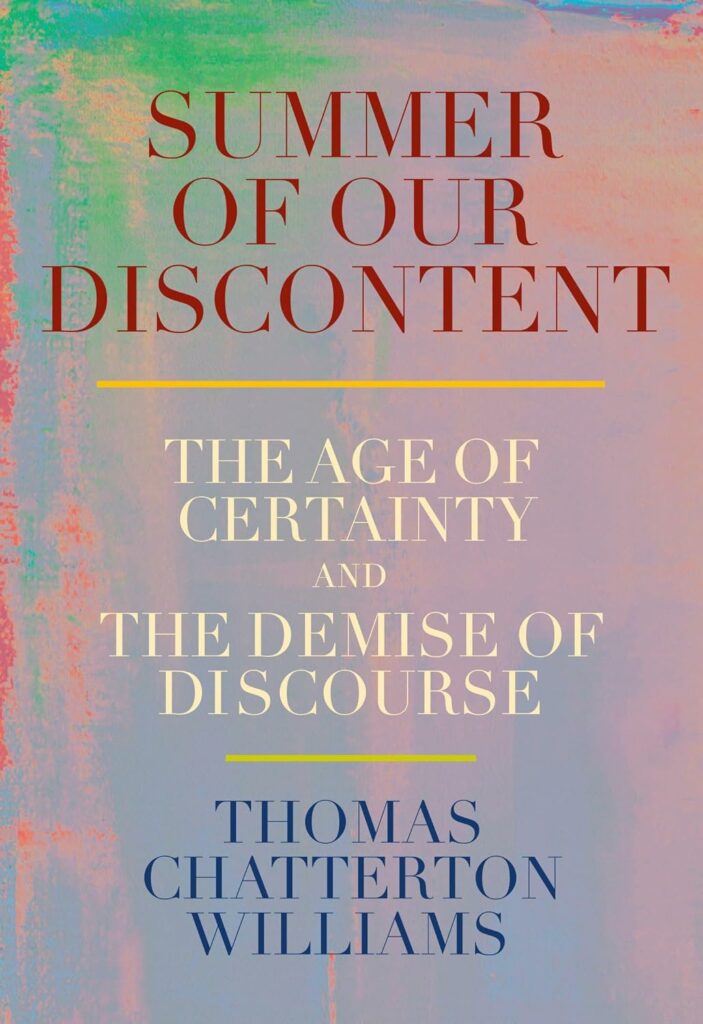
Pour un rappel frappant de l’ampleur du changement de zeitgeist, il suffit de lire le nouveau livre très éclairant de Thomas Chatterton Williams, Summer of Our Discontent: The Age of Certainty and the Demise of Discourse3. Williams explore comment la « saison de rébellion et de jugement » qui a suivi la mort de George Floyd aux mains du policier Derek Chauvin à Minneapolis, en mai 2020, fut le point culminant d’une période indéniablement illibérale aux États-Unis. Un mélange explosif de facteurs – la dernière année du premier mandat de Trump, les confinements liés à la COVID-19 et le ressentiment racial latent qui s’était accumulé pendant des années – a ouvert une période de bouleversements sociaux et politiques autour des questions raciales et identitaires sans précédent aux États-Unis depuis des décennies.
Williams donne plusieurs exemples flagrants des excès identitaires qui ont suivi le meurtre de George Floyd. Il y eut le licenciement du rédacteur en chef du New York Times, James Bennet, après une révolte du personnel pour avoir laissé publier un éditorial du sénateur de l’Arkansas, Tom Cotton, appelant au déploiement de l’armée pour réprimer les émeutes dans tout le pays. Il y eut les manifestants, en grande partie blancs, de Portland « déguisés en militants Antifa » qui « ont assiégé et saccagé le centre-ville autour du Multnomah County Justice Center ». Il y eut l’éclosion soudaine de l’industrie « antiraciste », dans laquelle des auteurs comme Robin Di Angelo et Ibram X. Kendi ont enseigné à des millions de lecteurs et à des milliers de participants aux séminaires d’entreprise à mener une lutte interne obsessionnelle contre leur propre racisme et leurs préjugés indélébiles. Il y eut les interminables chasses aux sorcières, les défenestrations, les campagnes de pression et les capitulations des universités, des entreprises et des institutions d’élite à travers le pays.
Williams, notamment dans une critique du New York Times de Summer of Our Discontent, est attaqué pour s’en prendre à l’intolérance de gauche plutôt qu’à l’intolérance de droite. Mais c’est lui reprocher de n’avoir pas écrit un autre livre. Son thème central est qu’il est judicieux et même indispensable de procéder à « une évaluation sans sentimentalisme de la gauche de justice sociale et des institutions influentes qui lui ont tout cédé ». Il observe à juste titre que la vague coercitive et hystérique qui a suivi le meurtre de George Floyd au nom de la protection des identités « a rendu l’illusion désastreuse de Trump encore plus plausible pour des millions d’Américains ».
Donald Trump a constamment exploité les excès de cette gauche radicale pendant la campagne de 2024. Comme d’autres candidats démocrates lors des primaires de 2020, Kamala Harris s’est laissé emporter par la ferveur identitaire du moment, allant jusqu’à exprimer sa sympathie pour la campagne visant à réduire le financement de la police. Comme l’a noté Williams, cette initiative a été « catégoriquement rejetée » par les électeurs de Minneapolis, lassés de voir leur ville brûler, et s’est rapidement révélée très impopulaire dans tout le pays. La campagne de Trump en 2024 s’est concentrée sur les questions de guerre culturelle, diffusant des publicités offensives et affirmant que «le programme de Kamala est pour eux/elles, pas pour vous», l’accusant de soutenir l’utilisation des fonds publics pour financer les opérations de changement de sexe des immigrants en prison. Kamala Harris a tenté de mener une campagne unificatrice qui minimisait les questions identitaires, mais elle n’a pas pu échapper à ses déclarations et positions passées.
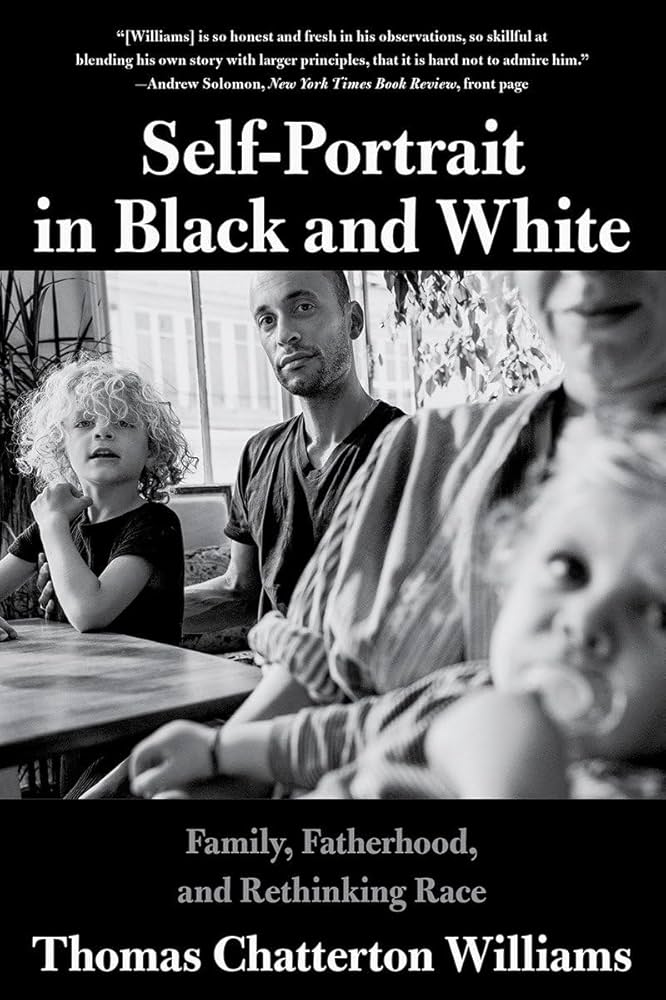
Summer of Our Discontent ne se contente pas de présenter un argument tactique contre « la politique identitaire mal conçue de la gauche » impuissante à contrer le « populisme malveillant de la droite ». La position de Williams est plus radicale : il s’oppose à la « barbarie » et au « mensonge » de la théorie de la race dans son ensemble. Ces arguments s’appuient sur le plaidoyer profondément personnel et émouvant en faveur du post-racialisme que Williams développe dans ses mémoires publiées en 2019, Self-Portrait in Black and White: Unlearning Race4.
Dans l’un des passages les plus saisissants et les plus nuancés de Summer of Our Discontent, Williams discute la tension entre l’universalisme qu’il considère comme un idéal politique et la réalité et l’héritage de la discrimination raciale. Il condamne le « wokisme » pour sa « subordination de l’identité individuelle à l’identité collective et la fétichisation des différences raciales et autres ». Mais il reconnaît également qu’il existe « une multitude d’oppressions passées sur lesquelles ruminer, et qu’un nombre non négligeable d’entre elles continuent de nous affecter de manière nouvelle et parfois subtile ». Compte tenu des énormes disparités raciales qui persistent aux États-Unis – qu’il s’agisse de la richesse des ménages, des taux d’incarcération ou des niveaux d’éducation – l’espoir de l’ère Obama de voir le pays devenir comme par magie post-racial du jour au lendemain a toujours été une utopie.
Le mouvement des droits civiques est peut-être l’exemple le plus convaincant et le plus réussi d’action politique de masse dans l’histoire américaine, et il était explicitement orienté vers la poursuite de l’égalité raciale. Si le mouvement avait des objectifs universalistes, il serait étrange de demander aux Noirs américains de cesser de se mobiliser autour de l’axe politique de la race à un moment où des disparités profondes persistent. On ne peut pas simplement ignorer une histoire toute d’oppressions passées, et l’on ne devrait même pas le vouloir.
Pour illustrer cette tension, Williams raconte son expérience lors d’une conférence en Normandie en 2021, où il participait à un panel aux côtés de la journaliste et militante Rokhaya Diallo, dont les parents ont immigré en France depuis le Sénégal et la Gambie. Lui et elle étaient deux des rares personnes « non blanches » dans la salle. Dans un pays où les classifications raciales officielles sont illégales, Rokhaya Diallo est ce que Williams décrit comme une « militante d’une politique identitaire sans détours ». Alors que Rokhaya Diallo avançait certains arguments qui lui semblaient parfaitement sensés, comme l’idée que l’identité pouvait offrir des formes d’expérience uniques, il fut surpris de constater qu’elle était « de fait isolée du reste du panel », en butte à l’hostilité du modérateur, et il entendit même « des sifflements ici et là dans le public lorsqu’elle prenait la parole ». Alors que Williams la considérait comme une adversaire avant cette rencontre, il s’est rendu compte qu’on la traitait injustement. Tenant à discuter avec elle après le panel, il est saisi par l’émotion. « Je voulais simplement, comprend-t-il, lui faire savoir que j’avais moi aussi vécu ce qu’elle avait vécu. » Williams en conclut que « toute tentative de comprendre la réalité contemporaine […] devra de plus en plus prendre ses arguments au sérieux, et non pas simplement les rejeter ».
Tomas Chatterton Williams aurait pu écrire un livre triomphaliste. Cela fait plusieurs années qu’il met en garde contre l’impasse politique que représente la politique identitaire, et il a été l’un des premiers à reconnaître à quel point l’atmosphère d’orthodoxie et de répression était devenue étouffante à l’été 2020. En tant que l’un des auteurs de la fameuse lettre publiée dans Harper’s en juillet 2020, On Justice and Open Debat, Williams a fait l’expérience de la façon dont même une déclaration anodine de soutien aux principes libéraux fondamentaux tels que le « libre échange d’informations et d’idées » pouvait être assimilé à une défense de la suprématie blanche ou de la transphobie. Il met en garde depuis longtemps contre le fait que ce que la lettre décrit comme «l’intolérance envers les opinions contraires, la vogue de l’humiliation publique et de l’ostracisme, et la tendance à dissoudre les questions politiques complexes dans une certitude morale aveuglante» renforcerait le pouvoir des populistes et des autoritaires de droite – argument désormais pleinement confirmé.
Williams a plutôt choisi d’écrire un livre qui remet en question la certitude morale aveuglante qui a caractérisé cet épisode de rébellion et de jugement péremptoire, ainsi que la réponse cynique de la droite de type MAGA. «Je suis convaincu, écrit-il, qu’une société véritablement aveugle à la couleur de peau est la destination finale vers laquelle toute société occidentale doit certainement se diriger.» Loin du centrisme libéral mou, il appelle à un projet universaliste radical, dans lequel serait abandonné la fixation arbitraire sur la race et où la politique viserait l’épanouissement de tous les êtres humains. En fait, il estime qu’il est temps de se débarrasser complètement du concept grossier et contraignant de «race».
Mais Williams est suffisamment empathique et réaliste pour comprendre que la race reste un sujet sensible pour beaucoup de ses concitoyens, comme le prouve sa rencontre avec Rokhaya Diallo. Il souhaite dialoguer avec ces militants, non les rejeter ou tenter de les réduire au silence. Alors que l’administration Trump mène une campagne de terre brûlée pour écraser jusqu’à la dernière poche de conscience sociale sous le talon de l’État, l’appel de Williams à la retenue et au dialogue trace une voie vers le retour à la raison.
Matt Johnson

Matt Johnson est essayiste et auteur de How Hitchens Can Save the Left: Rediscovering Fearless Liberalism in an Age of Counter-Enlightenment, Kalorama (2023)
Notes
| ↑1 | Persuasion est une excellente revue américaine dont les principes et les angles sont proches de Contreligne. |
|---|---|
| ↑2 | Voir Le Monde, L’élection de Donald Trump, « une réponse aux “gourous antiracistes”, quatre étés après le meurtre de George Floyd ». |
| ↑3 | Thomas Chatterton Williams, Summer of Our Discontent: The Age of Certainty and the Demise of Discourse, Knopf, 2025. |
| ↑4 | Thomas Chatterton Williams, Self-Portrait in Black and White: Unlearning Race, WW Norton & Company, 2019. |