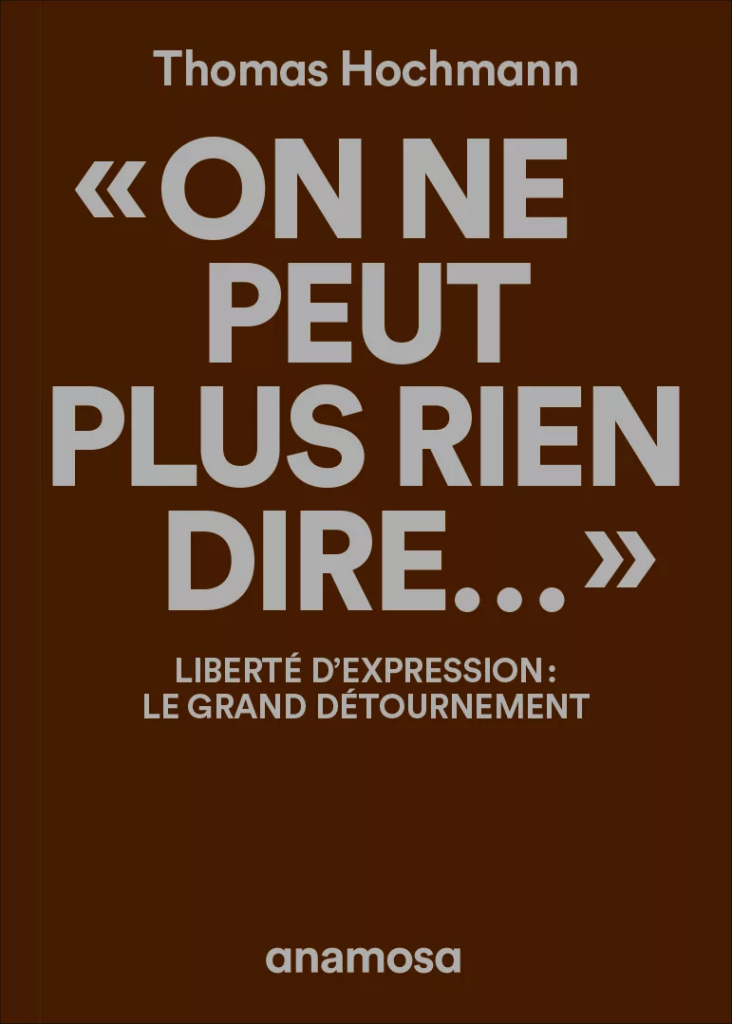
C’est un essai peu convaincant que livre le professeur de droit Thomas Hochmann.
En bon pédagogue, il sait rappeler comment la liberté d’expression est instituée en droit français : autour d’un principe de liberté, qu’il appartient au législateur d’aménager, et auquel il peut prévoir certaines exceptions. Selon l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. ». Un principe de liberté, des exceptions définies par la loi, c’est encore sur ce modèle que la liberté d’expression existe en droit positif. « En vérité, note justement Thomas Hochmann, il n’existe rien de tel qu’un droit absolu de dire tout et n’importe quoi. La liberté d’expression s’exerce dans le cadre des lois qui la réglementent. Le droit français comme le droit européen s’opposent fermement aux discours de haine et aux campagnes de désinformation tels que les propagent les médias d’extrême droite » (p. 6).
C’est parfaitement exact. Il n’est pas vrai que notre liberté d’expression soit totalement neutre devant les contenus et les autorisent tous (page 43). Certains propos sont « tabous », et c’est très bien, ajouterons-nous, dans une démocratie civilisée : l’incitation à la violence et le racisme n’ont pas leur place ni dans la société civile ni dans la société politique ; il est normal que le droit positif restreigne la liberté d’expression quand elle y succombe, avec ces délits que sont par exemple la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence et la diffamation à raison de la race, de la religion ou de l’ethnie…
Ce n’est pas sur ce terrain qu’on conteste ce petit ouvrage, qui est d’ailleurs plus un article qu’un livre. Sa faiblesse vient des perspectives qu’il adopte sur les débats contemporains.
Faire taire manu militari ?
S’il rappelle justement que la loi a le droit de prévoir des exceptions au principe de liberté, Thomas Hochmann s’en sert seulement pour rappeler que les contestations actuelles de la part de l’extrême-droite sur le mode du « on ne peut plus rien dire » ne sont que des jérémiades devant les obstacles, légitimes à son sens et en tout cas légaux, que les lois leur opposent. Il faut aussi se garder, dit-il, de « percevoir toute contradiction comme une atteinte problématique à la liberté d’expression ».
Certes, mais c’est un peu court. Il tombe dans la tartufferie quand il écrit que critiquer les positions d’un individu est légitime même quand cela va jusqu’à appeler au boycott ou à l’annulation de sa conférence, ce qui, dit-il, ne constitue pas des restrictions dans la liberté d’expression mais des mises en œuvre de ce droit (implicitement, le droit du contestataire). S’efforcer de « faire taire » l’adversaire est en effet un usage parfaitement conforme de ce droit, note-t-il bizarrement (page 6).
C’est mettre sur le même plan la critique verbale, les manifestations à pancartes, et ce qui relève de l’intimidation, voire du coup de force et du coup de poing. La demande d’annulation et le boycott quand ils s’accompagnent d’intimidations physiques, ce que l’on a souvent observé ne lui en déplaise, ne sont pas des moyens légitimes en démocratie, et il serait malheureux que les tribunaux les jugent permis en droit positif. Quand l’actrice Adèle Haenel dit « on se lève et on se casse », elle utilise sa liberté d’expression de manière spectaculaire et intelligente. Quand un groupuscule empêche un professeur d’inviter un ancien ministre de la culture dans son cours (à Paris 1) ou interdit physiquement à une autre professeur de s’exprimer parce qu’il serait « sioniste », il s’agit d’autre chose, qui ne saurait être toléré dans une société démocratique.
L’auteur se refuse à voir le potentiel illibéral de la cancel culture issue de la mouvance woke (pour employer un mot qu’il récuse). Elle est pour lui anecdotique et sans rapport avec la vraie censure, puisque celle-ci ne saurait émaner que de l’Etat. C’est marquer de la complaisance pour les censures privées. À ce compte-là, on se demande pourquoi le sentiment général est que cette partie de l’opinion a un problème avec la liberté d’expression.
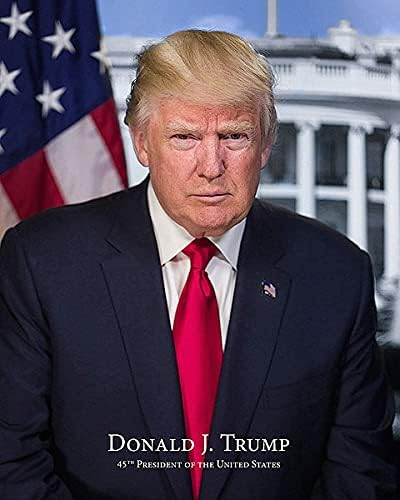
Au demeurant, parmi toutes les imbécilités qu’on peut attribuer au wokisme aux États-Unis, celle d’avoir contesté l’utilisation de certains mots ou la présence dans les bibliothèques de certains livres jugés offensants n’est pas la moindre : par un même mouvement, mais avec derrière eux une majorité plus grande, d’autres moyens et une hargne à laquelle on ne s’attendait pas, la mouvance MAGA est en train d’épurer méthodiquement les bibliothèques publiques.
Faire taire encore davantage au nom de la loi ?
Deuxième perspective encore plus difficile à accepter : Thomas Hochmann souhaite que la jurisprudence en matière de liberté d’expression soit durcie pour mieux censurer les positions de l’extrême-droite, son racisme et la désinformation.
Il rappelle à juste titre que la jurisprudence, le plus souvent, ne qualifie les opinion de délits à sanctionner que lorsque les expressions poursuivies contiennent un appel ou une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination1. Cette jurisprudence, note-t-il, a fait échec à la condamnation de nombreux discours susceptibles de faire naître haine et hostilité (p. 29 et 30).
« Conditionner la condamnation à une exhortation plus ou moins explicite revient à accorder une large protection aux propos racistes », regrette Thomas Hochmann (p. 33), qui cite les décisions qui ont relaxé Valeurs Actuelles, Christine Boutin ou Eric Zemmour. Tristes personnages sans doute, mais la première question est de savoir si la lutte contre leurs propos méphitiques passe par la sanction pénale plutôt que par le mépris, la réfutation ou la pédagogie. La tradition libérale conduit plutôt à retenir cette seconde voie – et spécialement la tradition républicaine, relevait Claude Nicolet2.
L’auteur lui oppose la jurisprudence au titre de la Convention européenne des droits de l’homme qui, dit-il, admet la sanction des « discours de haine » même s’ils ne sont pas suivis d’exhortation à la violence ou à la discrimination, parce qu’ils sont de nature à blesser leurs victimes. Il n’est pas certain que cette opposition entre la France et la jurisprudence européenne soit si justifiée, mais l’essentiel est ailleurs : à se limiter aux propos tenus sans considération de leur contexte, de leur moment, de leur objet et de leur effet…, le contrôle, la censure deviennent arbitraires. Or il est politiquement important que ces restrictions aux libertés restent dans le registre de l’évident et de l’indispensable, de ce qui dépasse toute objection politique.
Sans se poser beaucoup de questions, Thomas Hochmann souhaite même que ce durcissement aille au delà du racisme, afin de contrer les fake news et la désinformation (p.50) ; la cour constitutionnelle allemande et la cour suprême des Etats-Unis auraient indiqué la direction à suivre.
Fake news et désinformation sont des réalités bien visibles, mais comment les tribunaux spécialisés en délits de presse pourraient-il sans imprudence jouer les arbitres au sujet du changement climatique, de la guerre en Ukraine, de l’origine du covid. La qualité de l’information peut justifier l’intervention d’un régulateur, mais en vertu d’autres corpus que la liberté d’expression et ses exceptions3. Que les climatosceptiques ou les anti-vax profèrent leurs niaiseries, ce n’est pas une question qui doit se traiter sur le terrain de la liberté d’expression (à restreindre) ; c’est une question de qualité de l’information, laquelle ne relève pas du juge mais des directions des médias et de l’éthique du journalisme ; c’est une question de capacité de réfutation.
Pour reprendre les mots d’un essayiste qui avait l’art de la formule4, c’est là une bonne illustration de l’envie du pénal. La situation en France est satisfaisante précisément parce que le domaine des délits d’opinion reste limité. Il semble que le droit en Allemagne et surtout en Grande-Bretagne soit moins protecteur de la liberté d’expression, et certains exemples donnés récemment sont effectivement choquants5.
Bref, c’est là que Tomas Hochmann est inconsistant, ou du moins que son propos manque de netteté. On ne peut dire en page 12 que la liberté d’expression suppose à juste titre le droit d’exprimer des opinions désagréables, que certains vont détester, et demander dans les pages 50 et suivantes qu’on accroisse le domaine des opinions qu’on ne peut exprimer parce que certains les jugent offensantes, ou parce qu’elles seraient mensongères et fausses. On frôle le sophisme quand en plus, on prétend que la lutte contre la désinformation et les discours de haine est « consubstantielle à la liberté d’expression », et que la neutralité de la tradition libérale est un piège (p. 51). C’est se rassurer à peu de frais, et éviter de reconnaître qu’il y a bien des valeurs en conflit, entre lesquelles chaque droit national doit organiser une hiérarchie, selon son histoire, mais dans le respect de la tradition libérale.
C’est là tout l’embarras du livre : à force d’imaginer que les principes libéraux sont à corriger, que la neutralité est une valeur surestimée, l’auteur ne voit pas qu’il suffirait de nouvelles majorités pour que des valeurs vraiment illibérales viennent remodeler notre liberté d’expression. il n’imagine pas qu’un catéchisme peut vite en remplacer un autre.
Stéphan Alamowitch
Thomas Hochmann, On ne peut plus rien dire… Liberté d’expression : le grand détournement, éditions Anamosa (2025)
Notes
| ↑1 | Comme le note l’auteur d’un ouvrage récent, excellent, « une provocation à la haine n’est que rarement sanctionnée indépendamment de toute provocation simultanée à la violence ou aux discriminations. L’approche retenue est conséquentialiste : on ne sanctionne des propos que pour prévenir des actes répréhensibles. Le discours de haine n’est pas illicite parce qu’il est haineux, mais parce qu’il est dangereux (…) » Evan Raschel, Droit de la presse, p. 406. |
|---|---|
| ↑2 | L’idée figurait déjà dans le Troisième Mémoire sur la Librairie de Malesherbes de 1758. |
| ↑3 | On songe à la décision du régulateur de l’audiovisuel de juin 2018 contre une chaîne du groupe russe RT, épinglée pour une manipulation grossière à l’occasion d’un reportage télévisé consacré à la guerre en Syrie. |
| ↑4 | Mais pas celui d’attirer la sympathie. |
| ↑5 | Sous la plume de Yascha Mounk, pas un libertarien ! Europe Really Is Jailing People for Online Speech – From Germany to Britain, citizens are now routinely targeted for what they say, Substack, 24 avril 2025. |