Zoé Grumberg, historienne du communisme et des mondes juifs en France après la Seconde Guerre mondiale, vient de publier Militer en minorité ? Le «secteur juif» du Parti communiste français après la Libération. Le titre ne dira rien à la plupart de nos lecteurs. D’autres se souviendront d’un grand-père, d’un arrière-grand-père que la tradition familiale décrit encore comme stalinien et qui a terminé sa vie désenchanté, amer. Contreligne l’a interrogée.

Contreligne – Avant et après la Libération, comment le Parti communiste français (PCF) a-t-il intégré les militants juifs dans ses rangs ? On ne peut pas dire que cette minorité présentait un grand intérêt électoral pour un parti qui atteignait alors des scores très élevés ? Pourquoi en est-on venu au PCF à leur assigner un « secteur » rien que pour eux ?
Zoé Grumberg –Dans les années 1920, la France est un pays d’immigration. Le pays a besoin de main-d’œuvre après la Première Guerre mondiale, ce qui attire un certain nombre de travailleurs qui viennent chercher du travail ou de meilleures conditions de travail que dans leur pays d’origine. Le contexte politique dans plusieurs pays d’Europe (fascisme, régimes autoritaires, guerres civiles) conduit aussi de nombreux individus à fuir et à prendre le chemin de l’exil : Italiens antifascistes, Polonais communistes dans un pays où le communisme est interdit sous Pilsudski, républicains espagnols, etc.

Parmi ces immigrés, on trouve de nombreux Juifs originaires d’Europe orientale, en particulier de Pologne et qui choisissent de quitter leur pays pour des raisons à la fois socio-économiques (l’antisémitisme en Pologne les met parfois en danger et complique leur insertion dans un certain nombre de certains d’activités, les quotas à l’université empêchent certains de poursuivre des études) et politiques (le communisme et les partis politiques juifs comme le Bund sont interdits dans la Pologne des années 1930).
Le PCF prend conscience de l’importance de la propagande vis-à-vis des étrangers, notamment dans une perspective d’augmentation de ses effectifs. Au milieu des années 1920, il crée une section du travail parmi les étrangers, la Main-d’œuvre étrangère (MOE) qui devient la Main-d’œuvre immigrée (MOI) en 1932. Cette MOI est composée de différentes sous-sections par langue ou nationalité, afin de permettre aux immigrés récents de pouvoir militer dans leur langue et défendre leurs intérêts, tout en prenant part aux luttes communes des communistes français. On compte ainsi un section arménienne, hongroise, polonaise, italienne, espagnole ou encore « juive ». Cette dernière est en fait une section yiddishophone, qui réunit tous les Juifs d’Europe orientale parlant le yiddish. Les Juifs immigrés non yiddishophones sont quant à eux membres des sous-sections de leur pays d’origine.
La sous-section juive de la MOI est l’une des plus dynamiques. Si elle n’a jamais rassemblé un nombre important de militants – seuls 250 Juifs y seraient affiliés au début des années 1930, le double au moment du Front Populaire – l’influence des Juifs communistes ne se mesure pas uniquement à l’adhésion. On estime ainsi que plus de 10 000 personnes lisaient le quotidien de la sous-section juive, Naye Prese, dans les années 19301, sur un total d’environ 300 000 Juifs en France dont plus de la moitié issus de l’immigration.
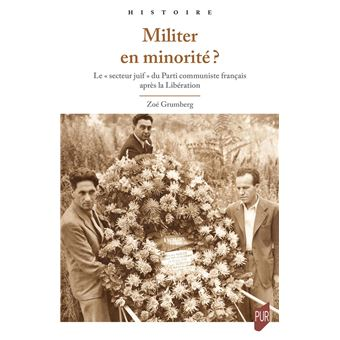
La sous-section juive développe par ailleurs de nombreuses organisations de masse à caractère social, mutualiste, culturel. La plupart de leurs membres ne sont pas adhérents au PCF, alors même qu’ils gravitent dans son orbite. Ce constat créé des tensions récurrentes entre les différentes sections de la MOI et le PCF qui rappelle régulièrement que les membres des sous-sections et de leurs organisations doivent aussi adhérer au parti. Pour le PCF, ces sous-sections ont un but très pragmatique : diffuser le communisme parmi les immigrés, tout en permettant l’intégration progressive des immigrés en son sein. À terme, l’objectif est que ces individus rejoignent uniquement les cellules françaises, notamment lorsqu’ils maîtriseront assez le français et qu’ils seront naturalisés (et partageront avec les Français les mêmes combats). Dans la réalité, l’histoire de la MOI est faite de tensions récurrentes entre les sous-sections et la direction du Parti, qui estime que celles-ci tendent à être trop autonomes.
Cette inquiétude est particulièrement forte après la Seconde Guerre mondiale. La clandestinité a conduit la MOI à être de facto plus indépendante vis-à-vis du PCF. Après la Libération, estimant que les immigrés ont « payé de leur sang » leur intégration en France, le parti entend réformer la MOI en supprimant une grande partie des organisations qui la composent. La MOI perd par ailleurs un certain nombre de ses effectifs qui retournent dans leur pays d’origine, qui pour y construire le socialisme (dans les démocraties populaires), qui parce que le fascisme est désormais tombé (Italie). Mais la section juive de la MOI résiste à cette politique du PCF. Elle est la seule sous-section à ne pas être liée à un parti communiste étranger. Seuls une minorité de ses membres repartent dans leur pays d’origine pour construire le socialisme.
Ceux qui restent mobilisent plusieurs arguments pour convaincre le PCF de ne pas supprimer la sous-section juive : la guerre, disent-ils, a laissé la population juive exsangue et seule une section juive au sein du PCF pourra véritablement défendre ses intérêts ; sur un plan politique, disent-ils aussi, si le PCF supprime la section juive et ses organisations de masse en yiddish, cela laissera toute la place à leurs ennemis politiques yiddishophones : les bundistes et les sionistes. Ce deuxième argument convainc le PCF, qui accepte de maintenir la section juive de la MOI – à l’exception des organisations pour la jeunesse – qui devient bientôt le « secteur juif » du PCF.

Cette politique du PCF vis-à-vis des Juifs fait en fait écho à la politique soviétique vis-à-vis des minorités nationales, encouragées à diffuser le contenu socialiste sous une forme nationale (notamment dans leur langue). Les Juifs yiddishophones peuvent défendre les intérêts, mais ils ne doivent jamais perdre de vue la ligne du parti et les combats du PCF, auxquels ils doivent prendre part. Ils sont par ailleurs étroitement surveillés par le PCF – comme n’importe quel secteur du PCF.
Ce secteur » n’était-ce pas une façon pour eux de refuser l’assimilation que recherchaient souvent les autres juifs de cette époque après la mise à l’index des années 40, et au fond de rester dans un recoin de la contre-société communiste comme dans un ghetto qu’ils n’étaient pas encore prêts à quitter ?
Question complexe ! Depuis les années 1990, l’historiographie des mondes juifs en France a nuancé l’idée d’une « assimilation » des Juifs, et parle plutôt d’une « acculturation » et d’un modèle « intégrationniste » qui aurait conduit les Juifs de France à ne pas renoncer à leurs particularismes. C’est notamment le cas des Juifs d’État sous la IIIe République, étudiés par l’historien Pierre Birnbaum. Cette historiographie porte surtout sur les Juifs qualifiés « d’Israélites », c’est-à-dire les Juifs présents sur le territoire français avant la Révolution française pour certains.
Dans le cas des Juifs issus de l’immigration récente, celle du premier XXème siècle, le processus d’intégration a été différent. Entre 1906 et 1939, entre 150 000 et 200 000 Juifs, la plupart originaires d’Europe centrale et orientale, arrivent en France. Ils apportent avec eux toute la diversité de leur pays d’origine, aussi bien sur le plan religieux que politique. S’ils adhèrent au modèle français d’intégration, il n’en reste pas moins que la première génération d’immigration reste une première génération d’immigration, qui évolue en grande partie dans des cercles d’immigrés. Parmi ces immigrés, les Juifs communistes représentent justement un groupe perçu parfois comme plus extérieur au groupe, comme ayant cherché à s’en émanciper, en rejoignant un parti non-spécifiquement juif, contrairement aux bundistes ou aux sionistes.
L’historien Isaac Deutscher a ainsi qualifié les Juifs communistes de « Juifs non-juifs », en référence notamment à leur pensée universaliste. Annie Kriegel estimait quant à elle que le communisme proposait aux Juifs d’échanger leurs particularités contre celles d’une classe, la classe ouvrière. Ma thèse a nuancé ces analyses, en montrant que les membres du secteur juif conciliaient en fait plusieurs appartenances et identités : l’appartenance communiste ; l’appartenance juive, en continuant à défendre les intérêts des Juifs et à militer dans le monde juif yiddishophone ; l’appartenance à la France, pays duquel ils aspiraient à devenir des citoyens à part entière, sans pour autant renoncer à leur identité juive ; ces identités sont mouvantes en fonction des milieux et des contextes.

Quels étaient les profils des militants juifs du PCF après 1945 ? Comment leur engagement communiste dialoguait-il avec leur identité juive, marquée par la Shoah ? Quels étaient leurs rapports avec les autres segments du monde juif dans cette après-guerre ?
La spécificité du secteur juif du PCF après 1945 est qu’il est constitué des mêmes militants qu’avant-guerre, ceux qui ont survécu à la persécution et à la répression de la Résistance. Il s’agit souvent d’individus nés dans les années 1900-1910, pour la plupart en Pologne, dans des familles traditionnelles (religieuses sans être orthodoxes) et qui sont souvent les premiers militants de leur famille. Leur engagement politique en Pologne – parfois dans le Parti communiste dès le début, parfois dans des partis marxistes juifs, bundistes ou sionistes – les conduisent à militer clandestinement avant, parfois, d’être arrêtés et de connaître la prison. Les risques qu’ils encourent les conduisent à émigrer, en passant pour certains par des pays comme la Belgique et l’Allemagne avant d’arriver en France, qui est perçue comme le « pays des droits de l’homme » et des révolutions.
Ces trajectoires d’immigration les confrontent à une forme de déclassement social : certains ne pouvant pas exercer le métier pour lequel ils avaient été formés, ni poursuivre les études qu’ils avaient entamé. En France, ils militent dans la MOI dans les années 1920-1930. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils s’engagent pour beaucoup dans la Résistance, dans la MOI clandestine et les FTP-MOI, particulièrement connus depuis la panthéonisation de Missak et Mélinée Manouchian en février 2024.
Après-guerre, au sein du secteur juif, ils cherchent à concilier défense des intérêts des Juifs et celle du communisme. Dans l’immédiat après-guerre, ils se battent notamment contre les spoliations qui ont touché les Juifs, contre les relents d’antisémitisme, pour l’obtention de statuts et d’aides économiques pour les Juifs victimes de la guerre. Ils développent aussi une forte activité mémorielle en créant un centre de documentation qui réunit des documents sur la persécution et la résistance des Juifs, organise des expositions, etc. Ils recréent aussi des espaces de vie sociale, notamment autour d’activités culturelles (chorale notamment).
Toutes ces activités sociales et culturelles sont aussi un moyen d’essayer de diffuser le communisme le plus largement possible auprès des Juifs qui viennent s’adresser à eux et bénéficient des structures qu’ils développent (dispensaires, cantine, vestiaire, caisse de prêt sans intérêt, etc.). Dans les premières années d’après-guerre, ils cherchent aussi à mener des actions communes avec le reste du monde juif yiddishophone (et, dans une moindre mesure, l’ensemble du monde juif) même si la concurrence domine les relations entre tous les segments du monde juif yiddishophone après-guerre. Et, très vite, les conflits politiques prennent le dessus dans le contexte de la guerre froide…
Outre leur combat pour les droits des Juifs et la défense de leurs intérêts, les Juifs communistes participent évidemment à tous les combats du PCF au sein duquel ils militent dans les cellules de leurs quartiers. C’est le « contrat » passé avec le PCF.

Comment ces militants ont-ils vécu les différentes étapes qui ont fait comprendre la nature du stalinisme et plus généralement du communisme ? L’affaire Kravchenko, le « complot des blouses blanches », Budapest en 1956 et Prague en 1968 ? Les contacts avec les juifs russes leur ont-ils ouvert les yeux sur la réalité soviétique ?
Face à l’antisémitisme soviétique (disparition des membres du Comité antifasciste juif en URSS en 1948, procès de Prague en 1952, complot dit des Blouses blanches en 1953), les Juifs non-communistes attaquent les Juifs communistes et leur demandent de prendre position. Or, le secteur juif du PCF reste dans la ligne du parti et refuse de condamner l’URSS. Certains pamphlets publiés par des membres du secteur juif au début des années 1950 témoignent de leur aveuglement et de leur incapacité à voir l’antisémitisme stalinien. Au niveau de la base, des défections ont lieu à cette époque, mais elles ont laissé peu de traces dans les archives. Les échanges dans le monde juif yiddishophone sont extrêmement violents et conduisent à un point de non-retour au début des années 1950 : le monde juif est alors durablement divisé entre les Juifs communistes d’un côté, et les Juifs non-communistes voire anti-communistes de l’autre. La position publique et officielle du secteur juif ne signifie toutefois pas que des doutes n’ont pas tenaillé ses membres, y compris les dirigeants. Des échanges entre eux, des lettres à Maurice Thorez, des discussions dans les familles montrent que certains s’interrogent. En 1956, le PCF a d’ailleurs dû reprendre en main le secteur juif, estimant que les discussions en son sein étaient trop houleuses et que ses dirigeants ne parvenaient plus à tenir la base.

par Lamy et Georges Rival, 1954 Archives du PCF
La plupart des dirigeants a donc choisi de taire ses doutes ou de les garder pour eux, au profit du combat pour un monde meilleur. Il faut toutefois ajouter que la sociologie des mouvements sociaux et en particulier les travaux sur le désengagement, tels ceux de Catherine Leclercq, ont souligné la difficulté à rompre avec l’engagement politique tant il structure souvent tous les aspects de la vie : intime, personnelle, professionnelle et amicale. C’est une dimension à prendre en compte pour ne pas réduire uniquement à de l’idéologie les choix effectués par les dirigeants du secteur juif.
Vous dites aussi que très tôt, certains militants se détachent de l’orthodoxie communiste au sujet de la préservation de la culture yiddish en URSS ou du soutien à Israël, le monde d’avant et le monde d’après auxquels ils se sentent liés en dépit de tout ?
Effectivement, j’ai constaté que la rupture de certains avec le communisme était liée à des questions juives, en l’occurrence la préservation de la culture yiddish en URSS pour l’un d’entre eux, qui est l’un des rares à avoir rompu avec fracas : le dramaturge et avocat Haïm Slovès. Dans les années 1950, il entame une correspondance avec Maurice Thorez – signe de sa foi dans le PCF et de l’idée, peut-être naïve, que le PCF pourrait avoir une influence sur la politique soviétique – afin de l’alerter sur la disparition de la culture yiddish en URSS. Il réussit même à organiser le voyage en URSS d’une délégation du secteur juif pour aller voir sur place ce qu’il en était.
Face à un voyage contrôlé par les autorités soviétiques, et qui révèle par exemple que les acteurs des théâtres yiddish ne sont pas juifs et ne parlent pas vraiment yiddish (ils apprennent les textes par cœur), Slovès n’est pas rassuré. À son retour, il refuse de signer une déclaration, écrite par les membres du secteur juif ayant participé au voyage, selon laquelle la culture yiddish se porterait bien en URSS. Après plusieurs années de discussions avec Thorez, sans résultat, il prend acte de la situation et décide, avec difficulté, de rompre avec le parti. Cette décision est extrêmement difficile à prendre pour lui, qui a toujours lié son engagement communiste avec son identité juive.
Rompre avec le parti, c’était rompre avec une manière de penser et une vision du monde, avec un cercle social et politique… Sa rupture ne s’accompagne d’ailleurs pas d’une réorientation politique : il reste fondamentalement ancré à gauche. Mais il choisit d’être en cohérence avec ce qu’il défend.
La question d’Israël ne conduit pas les Juifs communistes à rompre avec le PCF. Les membres du secteur juif ont toujours eu une position claire sur le sujet : ils sont pour l’existence de l’État d’Israël – qu’ils voient comme le seul refuge des Juifs d’Europe orientale qui n’ont pas pu rentrer chez eux et qui ont été les victimes de pogroms après la guerre – mais ils s’opposent à la politique de prédation des terres palestiniennes hors des décisions de l’ONU, ainsi qu’aux inégalités entre Juifs et arabes. Ils continuent par ailleurs à défendre la vie en diaspora : il n’est pas question pour eux d’aller s’installer en Israël. Cela les conduit parfois à entrer en tension avec le PCF – par exemple, le PCF peut refuser à certains militants des déplacements en Israël pour voir leur famille – sans que cela soit la cause d’une rupture dans la période que j’étudie. L’historiographie a montré que la crainte de la disparition d’Israël avait été un choc pour beaucoup de Juifs, y compris communistes. Il n’est pas impossible que d’autres ruptures aient eu lieu à cette époque, compte-tenu de la position du PCF sur le sujet.

La plupart des ruptures avec le Parti – minoritaires chez les militants que j’ai étudiés, qui étaient tous des cadres intermédiaires et supérieurs du secteur juif – se sont faites « sur la pointe des pieds », sans qu’ils recherchent à publiciser la rupture et les critiques. Les militants leur expérience militante dans d’autres secteurs d’activité, notamment le monde associatif juif. Si l’application réelle du communisme les a déçus, ils ont continué à croire en cette idéologie porteuse d’espoir, contrairement à une génération suivante, par exemple celle d’Annie Kriegel, qui a pu passer du communisme à un engagement politique à droite.
En fermant votre livre, on se dit que ces militants des années 50 furent le dernier signe d’un monde qui a fini de disparaitre avec eux, presque incompréhensible aujourd’hui, non ?
Aujourd’hui, quand je parle de mon livre, on me demande parfois, étonné « Il y avait des Juifs communistes ? ». Cette interrogation émane autant de Juifs que de non-Juifs. Cela montre en effet l’écart qui a pu se creuser entre la gauche et les Juifs aujourd’hui. Pourtant, il existe encore des Juifs de gauche. Le 7 octobre 2023 et les représailles israéliennes à Gaza ont donné lieu à beaucoup de confusions et de débordements antisémites (plus ou moins conscients), en particulier émanant d’un parti de gauche en France. Le confusionnisme entre les Juifs et Israël (je rappelle que les Juifs de France sont Français et qu’ils ne sont pas responsables de la politique israélienne) et l’impression d’être abandonnés par leur famille politique a conduit des Juifs de gauche à se réunir, par exemple dans le mouvement « Golem » ou dans l’association ARRAC, pour Association de recherche-actions sur les racismes et l’antisémitisme contemporains, ou à lancer la nouvelle revue juive, Daï ! « une revue juive de gauche, libre de toute affiliation ». Si ces initiatives ne réunissent pas l’essentiel du monde juif de France, loin s’en faut, elles témoignent toutefois d’un dynamisme et d’une volonté de renouvellement.
Un personnage vous a-t-il particulièrement marqué lors de vos recherches ?
J’ai toujours eu du mal à isoler un individu en particulier, tant cela en laisse d’autres dans l’ombre. Il y a bien un nom qui me vient, celui d’une figure passionnante au sein du secteur juif : David Diamant, un militant qui s’est formé à la documentation et est devenu le documentaliste du centre de documentation de la principale organisation juive communiste. Il a mené un travail impressionnant de collecte d’archives et ensuite, toute sa vie, il a œuvré à récolter des témoignages et documents sur la résistance des juifs communistes. Il est à l’origine du fonds d’archives éponyme d’une richesse fondamentale pour les historiens et historiennes. C’est grâce à son travail que j’ai pu travailler.
Mais les figures qui m’ont le plus marquée, ce sont peut-être les enfants des militants du secteur juif qui ont accepté généreusement de me parler de leurs parents, de ce monde disparu et de la transmission. Sans eux, ma thèse aurait manqué de « chair » et de concret, je n’aurais pas autant touché du doigt ce qu’était ce monde, les accents yiddish, les rues où les Juifs communistes militaient, les relations interpersonnelles qu’ils entretenaient. Et ces rencontres ont aussi été déterminantes pour faire de moi l’historienne que je suis : aujourd’hui, l’histoire orale est plus que jamais au cœur de mon travail et mon nouveau projet de recherche porte notamment sur la transmission intergénérationnelle du politique. J’écris donc la suite…
Propos recueillis par Nicolas Tisler et Stéphan Alamowitch (janvier 2026)

Zoé Grumberg, Le « secteur juif » du Parti communiste français après la Libération, Presses Universitaires de Rennes, 2025
Zoé Grumberg est historienne. Elle est spécialiste de l’engagement politique, des mondes juifs, de la Shoah et des enfants, et de la prise en charge de l’enfance en contexte de guerre et de sortie de guerre
Photographie de Une : commémoration au Père-Lachaise en l’honneur de deux résistants juifs communistes fusillés en 1942 (probablement 1947)
Notes
| ↑1 | Renée Poznanski, « On Jews, Frenchmen, Communists, and the Second World War » in Jonathan Frankel (ed.), Dark Times, Dire Decisions. Jews and Communism, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 168‑198 ; Nick Underwood, « Our Most Beautiful Children: Communist Contests and Poetry for Immigrant Jewish Youth in Popular Front France », Jewish Social Studies, 2017, vol. 23, no 1, p. 64‑100. |
|---|