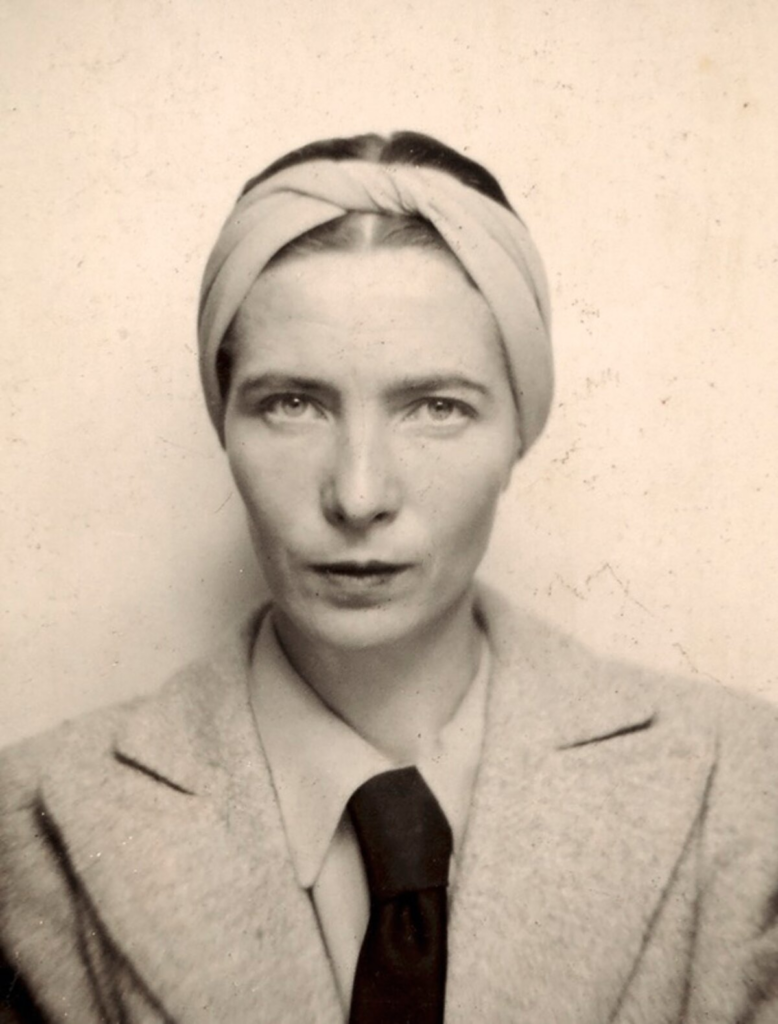
Lors du colloque organisé pour le cinquantième anniversaire du Deuxième Sexe, à Paris, en 1999, il était mal vu de parler de Simone de Beauvoir et de son amour des hommes. À cette époque, il n’y avait guère que les féministes pour s’intéresser à ce nom, encore l’intérêt était-il très sélectif : rien d’autre n’existait que l’ouvrage fondateur du féminisme moderne et de la notion de genre. L’université française dédaignait l’œuvre littéraire de celle qui n’était considérée que comme une intellectuelle féministe. Intellectuelle, certes, mais pas écrivaine, pas romancière. Ou encore mémorialiste : l’autobiographie de Simone de Beauvoir rejoignit le cercle distingué des auteurs de la Pléiade en 2018. L’autobiographie, certes, mais pas les romans.
Et pourtant elle était romancière…
Dès 19981, j’écrivais qu’il était temps de prendre conscience que l’œuvre de Beauvoir était un jeu complexe de miroirs, dans lequel fiction, essais, autobiographie, correspondances, c’est-à-dire les différents genres de textes qu’elle avait pratiqués, cherchaient à saisir les multiples facettes de l’autrice, et que la philosophe était, entre autres, une grande romancière !
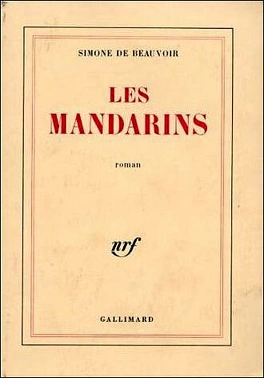
Comment ne pas s’émouvoir à la lecture du récit Le Sang des autres, circonscrit dans l’espace d’une nuit, en face du déchirement de cet homme qui assiste aux dernières heures de celle qu’il a envoyée à la mort ? Comme dans ce récit de jeunesse, le roman de la maturité, couronné par le prix Goncourt 1954, Les Mandarins, reprend et inverse, en la complexifiant, la double perspective du Sang des autres, incarnée par un homme et une femme, la femme étant de nouveau familière de la mort, ainsi que l’écrivaine l’a expliqué dans ses Mémoires : « Beaucoup de raisons m’incitèrent à placer auprès d’Anne un héros masculin. […] Beaucoup plus qu’un homme, une femme qui a pour vocation et pour métier d’écrire est une exception. Je n’ai donc pas confié mon stylo à Anne, mais à Henri. […] Ce sont surtout les aspects négatifs de mon expérience que j’ai exprimés à travers elle: la peur de mourir et le vertige du néant, la vanité du divertissement terrestre, la honte d’oublier, le scandale de vivre. La joie d’exister, la gaieté d’entreprendre, le plaisir d’écrire, j’en ai doté Henri ». La romancière a besoin de la diversité de ses personnages « pour ne rien sacrifier de ce qui a été déposé en [elle] ». « Oui, je crois que tout ce qui est en moi a le droit de vivre, je veux me sauver tout entière jusque dans mes misères », écrivait-elle à son amie d’enfance Elisabeth Lacoin, surnommée Zaza, le 28 août 1927.
Ainsi est-il vain et malvenu de hiérarchiser les rôles et de s’étonner que l’autrice ait prêté sa plume à un homme2. Si le statut d’écrivain était certes majoritairement marqué au masculin au milieu du XXe siècle, de telle sorte que nombre de femmes écrivains (pas seulement Beauvoir) cherchaient souvent à épouser l’identité masculine pour raconter, en particulier dans la distance de la troisième personne, il n’est nullement auréolé d’une quelconque supériorité dans le texte de Beauvoir, bien au contraire. Car celle qui nous émeut par la violence de ses déchirements, de ses amours, de la passion qui saisit son corps, c’est Anne, qui se raconte à la première personne.
À un certain moment cependant, la voix féminine devint prépondérante. Plus Simone de Beauvoir avançait en âge, plus son œuvre s’attachait à l’écriture du cri, du cri d’angoisse, de désespoir, du cri de celle qui succombe et résiste à la fois à l’anéantissement dont nous frappe le spectacle et la proximité de la mort au sein même de la vie. « L’important, c’est de crier », clame l’héroïne des Belles images. Une mort très douce est sans doute le récit le plus bouleversant de Beauvoir. Je le considérais dans mon essai déjà comme partie prenante de l’autobiographie, et il fut de fait intégré à la Pléiade. Il n’en reste pas moins un récit, le récit poignant où la bouche de la fille accomplit le cri que n’a pu pousser la bouche de la mère : le cri inopiné, stupéfiant, trop longtemps tu, le cri où l’autre se révèle être le même, surgi de la même bouche, du même sexe. L’âge de discrétion, La femme rompue et Monologue racontent chacun à sa façon « cette part d’échec qu’il y a dans toute existence » quand, en s’approchant de la mort, on en fait le bilan…
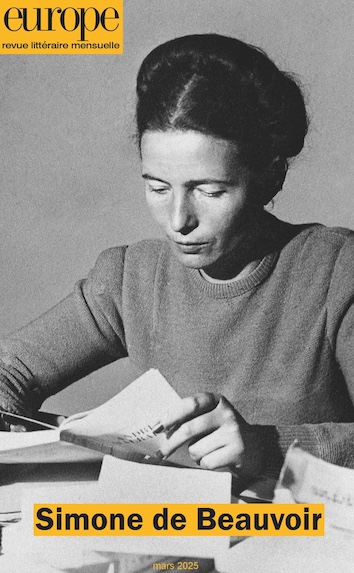
Et pourtant l’œuvre n’était pas achevée…
C’est aujourd’hui l’occasion de découvrir avec jubilation que Beauvoir n’avait pas dit son dernier mot. Grâce à sa fille adoptive qui gère le fonds littéraire, et par-delà la mort, elle continue à s’affirmer comme romancière et épistolière de premier ordre. Et miracle ! l’université devient enfin attentive à ses récits et à ses romans, trente ou quarante ans après sa mort. En 2013, un Cahier de l’Herne tentait de restituer à Simone de Beauvoir toute sa dimension d’écrivain et d’éclairer les différents genres dans lesquels son talent s’est exercé en soulignant un travail d’écriture souvent méconnu. La revue Europe se penche elle aussi, en 2025, sur les romans, récits et nouvelles : Quand prime le spirituel, L’âge de discrétion et sa version première Le Malentendu de Moscou3, jamais mentionné par la romancière, La Femme rompue, ainsi que Les Inséparables, édité par l’Herne en 2020.
Avez-vous jamais entendu parler de ce petit roman, écrit en 1954, et qui était resté dans les tiroirs de la célèbre essayiste, romancière et mémorialiste ? Pourquoi ne l’a-t-elle pas publié ? Parce que Sartre l’avait violemment critiqué ? Parce qu’il dépeignait une petite Simone encore sous l’emprise du catholicisme et de son amie Zaza ? Parce que la romancière le jugeait littérairement imparfait ? Qu’importe ! L’amitié passionnée entre les deux petites filles qui se soutenaient l’une l’autre dans l’adversité avec toute l’intensité de la jeunesse, son évolution, le destin tragique de Zaza, auquel Simone ne réussit pas à l’arracher, tout cela est extraordinairement poignant.
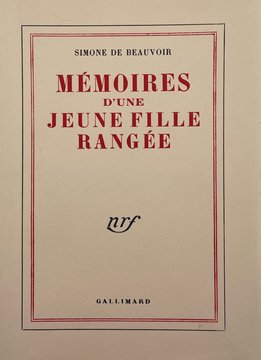
À la lumière de ce roman, le dernière phrase des Mémoires d’une jeune fille rangée prend plus que jamais des accents de tragédie : « Ensemble nous avions lutté contre le destin fangeux qui nous guettait et j’ai pensé longtemps que j’avais payé ma liberté de sa mort ».
Dans le cas où la lecture de ce roman posthume se révélerait addictive, il serait conseillé de se plonger dans les Lettres d’amitié (Gallimard, 2022). Ces lettres sont en elles-mêmes un roman, un roman à deux voix, de nouveau, mais toutes deux féminines, dans lequel la plume de Zaza (Elisabeth Lacoin) n’a rien à envier à celle de son amie ; le talent de cette jeune femme trop soumise à une mère abusive, est stupéfiant. Quel duo littéraire auraient formé les deux amies si Zaza avait survécu : la vie, la carrière, l’écriture de Beauvoir n’auraient sans doute pas été tout à fait les mêmes. Quel plaisir de découvrir comment ces deux petites, puis jeunes filles racontent pour les partager leurs joies devant les merveilles de la nature, leur éveil à la sensualité, leurs chagrins, leurs aventures amoureuses, et avec quelle maestria ! Comment ne pas s’extasier devant la culture et l’amour de la littérature de ces deux enfants dissertant sur leurs lectures ? Deux enfants appartenant malheureusement à un autre siècle…
À donner à lire de toute urgence aux adolescents et adolescentes d’aujourd’hui… Le plaisir serait plus total encore, à la fois sensuel et intellectuel, si la publication était dotée d’un appareil critique. Il est donc grand temps que toutes ces œuvres soient pléiadifiées !
Françoise Rétif

Professeure émérite des universités, essayiste, autrice (Simone de Beauvoir, L’autre en miroir, L’Harmatan, 1998 ; Ingeborg Bachmann. Ce qui est vrai, Vandenhoeck & Ruprecht, 2021 ; Le Tombeau de Marie-Louise, Tarabuste, 2020 ; Requiem pour une sœur Tarabuste, à paraître ; Ingeborg Bachmann, L’errante, Éditions Aden, à paraître.
Notes
| ↑1 | Françoise Rétif, Simone de Beauvoir. L’autre en miroir, Paris, L’Harmattan, 1998 |
|---|---|
| ↑2 | Élisabeth Russo, « Les Mandarins ou l’impossible roman féministe », in : Europe, n°1151, mars 2025, p. 62-63. |
| ↑3 | Publié aux éditions de l’Herne en 2013. Voir à ce propos l’article d’Éliane Lecarme-Tabone dans le numéro d’Europe. |