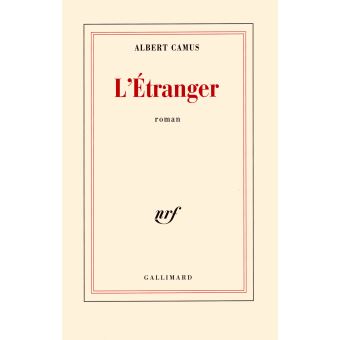
Difficile de lire ou de relire l’Etranger sans un sentiment de perplexité, de gêne qui vient rarement à la lecture des grands romans. Son héros n’appelle aucune sympathie ; sa psychologie profonde, ses actes sont peu compréhensibles ; il ne s’explique jamais – raison pour laquelle le roman a donné lieu à des commentaires si nombreux, si savants, et son personnage principal, Meursault, au premier chef.
Cependant il manque, même dans les ouvrages les plus intelligents écrits à son sujet, une idée qu’on voudrait avancer sans être un spécialiste de l’œuvre de Camus, loin de là, et sans avoir une connaissance exhaustive des interprétations qui entourent le roman depuis sa parution en 1942. Cette idée est celle-ci : le fait majeur du livre, ce n’est pas que son personnage principal tue un jeune Arabe, c’est que le romancier tue son narrateur. Aujourd’hui que le débat sur Camus prend un nouveau tour, qui est déplaisant, elle mérite d’être testée1.
Un narrateur méchant homme
Le roman est célèbre pour deux raisons au moins : le narrateur ne manifeste pour sa mère aucun sentiment relevant de l’amour filial, et c’est la froideur, même à l’annonce de la mort de celle-ci, qui transparaît dans tout ce qu’il exprime ; ensuite le narrateur ressent peur et hostilité envers un jeune Arabe au point de le tuer de plusieurs balles de revolver, acte de grande violence, irréversible, qui n’était pas forcément appelé par les circonstances de la rixe. Un narrateur qui ne parait pas souffrir de la mort de sa mère, qui n’exprime aucune douleur, qui ne se plaint pas ; un narrateur qui ne s’interroge pas sur les raisons de ses coups de feu et leurs conséquences pour la victime, qui ne les explique pas (sinon par le soleil), mais qui ne les regrette pas… Or il est bien connu qu’Albert Camus avait une immense affection pour sa mère, et aussi qu’il éprouvait de la sympathie pour le monde arabe, ce monde alors regardé par les Français d’Algérie avec condescendance quand ce n’était pas avec un racisme franc et direct.
Cette disposition d’esprit du narrateur, au sujet de sa mère comme au sujet du jeune Arabe, qui est présentée comme un fait, sans commentaire du romancier ou de son personnage, c’est le roman qui lui donne une sanction : Meursault est guillotiné. Dans l’Algérie coloniale, on l’a souvent dit et Camus le premier, un européen était rarement condamné à mort pour le meurtre d’un Arabe. Albert Camus choisit, dans L’Etranger, un châtiment sans réalisme, en romancier souverain de ses choix et de son intrigue, souverain de sa fiction.
Comment expliquer cette distance (du narrateur) envers sa mère et envers les Arabes et pourquoi lui avoir associé la peine capitale ?
La mère d’abord. Au fond de toutes les psychologies de fils, il y a probablement toujours une ambivalence et une touche de ressentiment, ouvert ou latent. Tout fils sait qu’il n’est pas un fils modèle et s’en veut forcément. « Fils modèle », c’est l’expression de l’avocat lors du procès, que Meursault sarcastique rappelle comme par antiphrase.
Pour la froideur envers les Arabes, dont la présence reste fantomatique dans le roman hors la victime, le mystère est probablement moins épais : comme tout pied-noir, ce narrateur vit dans une société où tout est conçu pour rappeler que volens nolens, les deux groupes sont différents, inégaux et que la violence n’est jamais loin, celle que l’on commet, celle que l’on subit. Le « Eux et Nous » est de tous les instants, sans rapport d’égalité. Quand Camus écrit l’Etranger, les tueries de 1945 n’ont pas encore eu lieu, mais il sait pertinemment que la vie collective en période coloniale n’est jamais dénuée de peur, de violence. Tout français d’Algérie avait mille occasions de le ressentir, sur le mode de la crainte, de l’agressivité et, pour quelques-uns, du repentir.
Même chez les européens progressistes parmi lesquels on rangera Camus, devait exister pour la population indigène une forme de condescendance plus ou moins consciente. La « condescendance » coloniale, effet d’un sentiment irrépressible de supériorité culturelle, est un meilleur terme ici que « racisme », qui suppose une intention politique malveillante, parfaitement consciente d’elle-même.
Imaginons que cette condescendance, Camus la portait nécessairement en une part de lui-même, tout comme il conservait forcément en lui certains sentiments négatifs, inavouables envers sa mère. Ce serait de l’ordre du semi-conscient, de l’inévitable , de ce que l’on porte en soi sans en être responsable, sans se le représenter clairement, mais toujours avec un sentiment de gêne. C’est avec cette argile qu’Albert Camus façonne Meursault, ce héros négatif qu’il installe au centre de sa fiction, qu’il fait s’exprimer à la première personne du singulier, dont il emprunte la voix pour écrire le roman.
Imaginons aussi, sans beaucoup d’efforts, que l’explication du meurtre par le soleil est une forme d’aveu : le soleil peut se voir comme la métonymie de l’Algérie (on parie que l’observation a déjà été faite par d’autres), et une façon commode mais brouillée de désigner la situation coloniale et la distribution des rôles qu’elle fait naître – et brouillée pour le romancier lui-même.

Les voies du salut
Et de là vient cette intuition : ce narrateur qu’Albert Camus envoie à l’échafaud, c’est la partie de lui-même qu’il n’apprécie pas, dont il veut se débarrasser dans un acte de catharsis et d’expulsion de sa psyché profonde. Par la guillotine qu’il promet à son narrateur, Albert Camus tue en lui aussi bien le mauvais fils que le méchant pied-noir. Il le crée, ce narrateur, puis il le liquide et s’en libère dans un mouvement qui prend 150 pages ; il le crée pour s’en libérer.
Cette liquidation doit s’accomplir au début de sa carrière littéraire, sans quoi (prêtons-lui cette pensée) il ne sera pas l’écrivain qu’il veut devenir. Le méchant pied-noir en lui, modelé par sa condition dans l’Algérie coloniale, ne pouvait peser plus longtemps sur l’homme et sur l’écrivain. Il devait disparaître – tout comme devait disparaitre le mauvais fils qu’il avait en lui, cet être insensible, qui du reste traite toutes les femmes du roman avec une froideur qui n’est pas ce que l’on prête au Camus de la maturité.
Pour une critique qui vient de faire un retour regrettable, le fonds colonial du romancier, sa vérité, se marquent par le fait que la victime de Meursault n’est pas vraiment identifiée, qu’elle reste une silhouette… Cette critique manque son objet. Ce narrateur qui ne voit pas la réalité humaine de sa victime, ce Meursault, Albert Camus choisit de le conduire à la guillotine. Il ne l’aime pas ; il s’en débarrasse. Le narrateur condamnait le jeune Arabe à l’anonymat ; le romancier condamne le narrateur à la guillotine. La tête ne pourra plus commander le corps. Le crime commis trouve dans la fiction un châtiment qu’il n’aurait pas eu dans la réalité car la fiction permet que la vraie loi, non le droit colonial, soit enfin appliquée.
C’est bien l’exécution du narrateur qui est le point d’orgue du roman, non les cinq balles qui tuent le jeune Arabe. Qu’on examine ce fait au lieu de reprocher au romancier son enracinement dans les psychologies et l’histoire de son temps. Moment de rappeler la définition de la liberté sartrienne !
Langue de chirurgien
Tous les lycéens l’apprennent : l’Etranger est écrit sans fioriture, sans beaucoup d’incises, de subordonnées qui viendraient moduler le récit, comme il s’en voit dans la plupart des romans ; L’Etranger est aussi écrit, de façon étonnante pour l’époque, presque entièrement au passé composé, ce temps qui n’est pas celui de la haute littérature, registre qui sera plus naturellement celui d’Albert Camus dans les œuvres qui suivront2. Albert Camus ne l’emploiera plus jamais ainsi dans ses autres romans. Quant au style indirect, il met bien en valeur la nature fantomatique de ce narrateur, créature de l’esprit et du cauchemar.
Cette langue de l’Etranger, souvent considérée comme élémentaire et neutre, est en fait de nature chirurgicale. Elle atteste le passé immédiat, dans sa nudité ; elle suit le narrateur au plus près ce qu’il éprouve, sans effet ni halo littéraire, fonctionnelle. C’est une langue de compte-rendu opératoire. Elle convient à l’ablation que le romancier veut pratiquer, l’ablation de la tête. Barthes, dans son essai de 1963, juge cette langue neutre, instrumentale, sans imaginer que cet instrument relève de la chirurgie et précisément de la chirurgie de guerre, une guerre livrée contre deux démons intérieurs, sa froideur de fils et sa condescendance d’Algérien, au sens colonial de l’époque si contraire au sens actuel, pour les Arabes…
C’est l’occasion d’imaginer que le romancier recourt à ce style caractéristique parce qu’ils correspond à son entreprise de catharsis, parce que le « style littéraire » ne pouvait convenir. Une fois la purgation faite, ce style perd son utilité, et Camus ne l’emploiera plus. Alors, comme le note dans En quête de l’Etranger Alice Kaplan, il peut commencer une nouvelle vie à Paris, laissant derrière lui cette « personnalité d’Alger » qui ne lui correspond plus, comme il l’écrit dans une lettre à un ami de lycée, Claude de Fréminville.
Au fond, cette narration ne relève pas de la littérature, au moins en première intention. Elle relève des exercices spirituels, ceux que préconise la tradition jésuite pour assurer le salut de son âme et la perfection de son être. Camus veut se purifier de ce qui le dégrade, et l’Etranger met en scène l’élimination d’un narrateur méchant homme. Le romancier conduit son personnage à la guillotine comme le Commandeur emmenait Dom Juan aux enfers.
Stéphan Alamowitch
Une première version de ce texte a paru dans les Chroniques camusiennes, publication de la Société des Etudes Camusiennes, de janvier 2024.
Lire aussi dans Contreligne : L’Etranger, de José Muñoz, par Alice Kaplan
Notes
| ↑1 | Ce texte aux intuitions qu’on peut juger aventureuses ne répond pas aux critères d’une publication universitaire, avec notes de bas de pages et vérifications méticuleuses. Il doit beaucoup au subtil et précis En quête de l’Etranger d’Alice Kaplan (Gallimard, 2016) et aux conversations avec son auteur, à qui l’on doit en outre la référence à la lettre de Claude de Fréminville mentionnée en conclusion. |
|---|---|
| ↑2 | Au point que certains de ses romans paraissent compassés, La Chute par exemple – avis personnel mais qui semble partagé. |