
Voir en Montaigne un précurseur du mouvement que nous qualifions aujourd’hui de « libéral », c’est sans doute assumer à la fois un anachronisme et une ambivalence. Au 16e siècle, le terme de « libéral » renvoie non à une doctrine, mais à une qualité éthique que l’on nommerait aujourd’hui la générosité. Le terme de « libéral » ne désigne une position politique que depuis la fin du 18e siècle, avec Benjamin Constant et Germaine de Staël. Actuellement même, on ne s’entend pas vraiment sur le sens du terme, qui renvoie en France à un mouvement de pensée opposé aux formes jugées excessives de collectivisme, alors qu’au 19e siècle, les libéraux étaient opposés aux monarchistes, et qu’aux États-Unis le liberal est encore généralement opposé au conservative (on peut traduire par « réformiste », voire, du point de vue de certains conservatives, par « gauchiste »).
Pour un auteur qui a lui-même pris la défense des « vaines subtilités », au sens de jeux d’esprit, cependant, rien n’empêche de poser ces questions : quel serait la place des Essais de Montaigne dans une préhistoire du libéralisme ? Et quel genre de « libéral » serait Montaigne, si on rapportait sa pensée aux écoles actuelles ?
Montaigne est-il un « éducateur » pour notre civilisation ? Les Essais peuvent-ils contribuer au dialogue contemporain autour du libéralisme ?
Si l’on en croit les historiens de la pensée politique moderne, le « libéralisme » serait avant tout une doctrine économico-politique teintée d’utilitarisme, mise en place au 18e siècle, avec Bernard Mandeville, Adam Smith, James Madison, Benjamin Constant, John Stuart Mill, etc. Mais, en remontant deux siècles plus avant, pour déceler les mutations anthropologiques et éthiques de la première modernité (« l’esprit libéral »), ne peut-on donner à ce libéralisme une assise un peu différente, voire lui conférer une nouvelle forme de légitimité, qui comblerait en un sens le déficit moral qui lui est souvent reproché ? De fait, il y a chez Montaigne une forme de révolution éthique, avec le rejet d’un code jugé suranné et la mise en valeur d’un certain nombre de vertus ignorées des anciens. Certains lecteurs, comme Judith Shklar, David Schaefer, David Quint ou encore Ann Hartle, ont déjà bien exploré cette dimension des Essais.
Montaigne fait profession d’une d’égoïsme vertueux. Il ne s’agit pas de dire que l’égoïsme est par lui-même vertueux, en ce qu’il produit des effets bénéfiques pour la société – ce serait là, du point de vue de Montaigne, confondre l’utile et l’honnête. Ne penser qu’à soi-même et être indifférent aux autres n’est pas particulièrement moral. L’égoïsme vertueux de Montaigne se distingue en cela de la « vertu d’égoïsme » d’Ayn Rand, qui défend un libéralisme holistique et reconnaît en la liberté la seule et unique valeur auxquelles toutes les autres devraient se soumettre.
L’égoïsme de Montaigne tire sa légitimité d’un cadre éthique qui lui est propre. Il ne s’agit pas de limiter un égoïsme libéral par des vertus républicaines, ni de dire, comme tendent à le faire certains défenseurs actuels des « vertus libérales » après Rawls, qu’il se modère lui-même en produisant ces vertus républicianes. Les qualités que Montaigne promeut, souvent sous la forme d’une description amusée de son propre caractère, ne sont pas directement liées à des formes d’altruisme, comme le sont la générosité, l’attention aux autres, le souci du public, l’engagement pour la cause, etc. Son égoïsme n’est pas essentiellement un altruisme, comme l’est la conciliato des stoïciens (comme appropriation à un soi collectif et universel). Montaigne promeut une appropriation non à un soi public, mais à un soi privé, qui doit à l’occasion affirmer ses prétentions et ses droits contre les exigences du public. Sénèque écrivait que le sage, en s’isolant de la foule, se faisait citoyen d’une communauté plus universelle, qui « embrasse les dieux et les hommes », en précisant « les hommes de tous les pays du monde, non seulement présents, mais à venir ». Montaigne, quant à lui, refuse que la préoccupation du public conduise à sacrifier « nostre faict et Michel, qui nous touche encore de plus pres que l’homme » (III, 9, « De la vanité », édition Villey, p. 952).
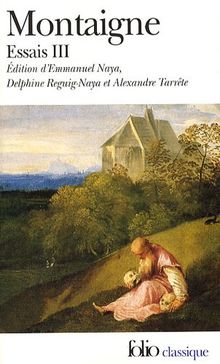
Le 5e livre des Lois de Platon condamnait l’amour de soi comme étant à l’origine de tous les vices. Cette condamnation a initié une tradition qui s’est développée en suivant deux branches. La première est théologique. Elle va d’Augustin à Raimond Sebond, dont Montaigne a traduit le Livre des créatures : la révolte contre l’ordre que représente l’amour de soi est la source première du péché. L’autre branche est politique, et on peut en suivre la trace la trace du De officiis de Cicéron jusqu’au républicanisme moderne : la vie communautaire implique que l’individualisme soit, sinon éradiqué, au moins sérieusement limité par un esprit « civique ». Un texte du chapitre « De mesnager sa volonté » définit assez précisément le rapport à soi-même et aux autres, tel qu’il est compris par Montaigne :
« Qui en sçait les devoirs [i.e. de l’amitié que chacun se doit] et les exerce, il est vrayement du cabinet des muses; il a attaint le sommet de la sagesse humaine et de nostre bon heur. Cettuy-cy, sçachant exactement ce qu’il se doibt, trouve dans son rolle qu’il doibt appliquer à soy l’usage des autres hommes et du monde, et, pour ce faire, contribuer à la société publique les devoirs et offices qui le touchent. Qui ne vit aucunement à autruy, ne vit guere à soy. Qui sibi amicus est, scito hunc amicum omnibus esse. La principale charge que nous ayons, c’est à chacun sa conduite; et est ce pour quoy nous sommes icy. » (III, 10, « De mesnager sa volonté », p. 1006-1007).
Qui ne vit aucunement à autruy, ne vit guere à soy.
Qui ne vit aucunement à autruy, ne vit guere à soy. Qui sibi amicus est, scito hunc amicum omnibus esse : cette formule bien balancée semble un moment vouloir modérer le discours égoïste quelque peu provocateur de certaines formulations du chapitre : « Il faut se prester à autrui et ne se donner qu’à soy-mesme », telles que « Il faut mesnager la liberté de nostre ame et ne l’hypothéquer qu’aux occasions justes ; lesquelles sont en bien petit nombre, si nous jugeons sainement »1. (III, 10, p. 1003-1007).
En réalité, ce bel équilibre est trompeur. Si l’on y regarde plus avant, les apparentes symétries entre « vivre à autruy » et « vivre à soy »-même » cachent une équivocité du terme « vivre à », de la même façon que la symétrie « parce que c’estoit luy ; parce que c’estoit moy » cache un déséquilibre plus profond. Il y a bien une priorité pour ainsi dire « lexicale », au sens de Rawls, de l’amour de soi sur l’amour des autres et sur les devoirs sociaux que les Anciens regroupaient sous le terme d’officia. Dans ce texte, c’est bien la connaissance des devoirs attachés à l’amitié pour soi-même qui fournit la règle et la limite des devoirs vis-à-vis des autres – alors que la réciproque n’est pas vraie.
Vertus civiques et républicaines
Alors, si ce ne sont pas des vertus de générosité et d’attention aux autres (attention chrétienne au prochain, attention civique au public) qui viennent modérer l’amour de soi, quelles sont ces vertus que l’on peut nommer « libérales » ? Ceux qui parlent des « vertus libérales », à commencer par Rawls à la fin de la Théorie de la justice, se réfèrent en dernier recours au registre assez classique des vertus républicaines de civisme et d’amitié politique. Ce n’est pas le cas chez Montaigne : il y a bien pour lui une « sagesse » de l’égoïsme, qui est même « le sommet de la sagesse humaine ». Mais cette sagesse est pensée par Montaigne sur un registre bien différent de la morale civique républicaine héritée de Cicéron et des historiens romains. On sait que cette tradition républicaniste a été réactivée sous différentes formes et dans des contextes divers, dans l’Italie du 15e et du 16e siècles, puis dans d’autres pays d’Europe, comme la France de l’époque de Montaigne, l’Angleterre du 17e siècle ou encore l’Amérique révolutionnaire du 18e siècle2.
Montaigne manifeste souvent son admiration pour les grands exemples antiques de vertu civique. C’est que cette morale républicaine est celle professée par l’aristocratie de son temps, et tout particulièrement par la noblesse de robe, celle des magistrats qui ne peuvent invoquer l’ancienneté de leurs titres ou les hauts faits d’armes pour légitimer leurs privilèges. Sous leur profession de dévouement civique, se cache une revendication à une participation plus active au pouvoir, confisqué par le Roi et son conseil3. Montaigne appartient lui aussi à cette classe aristocratique, et on trouverait bien des propos qui manifestent son attachement à ses valeurs, même s’il affirme par ailleurs ne plus croire à cet héroïsme civique dans les temps présents.

Mais il est intéressant de revenir aux moments où Montaigne se détache de ces valeurs, voire s’y oppose frontalement. Il le fait soit sur un ton prescriptif, soit sur un ton faussement descriptif, se vantant de sa « bonne nature », ou, plus souvent, s’« autodébinant », pour reprendre le terme de Jules Brody, en revendiquant tel ou tel défaut, dont le lecteur comprend vite qu’il est en réalité pour lui une qualité morale positive. Montaigne s’accuse ainsi de paresse, de nonchalance et d’oisiveté, de lâcheté et de poltronnerie, de mollesse, d’irrésolution, de lenteur d’esprit, de négligence, de superficialité et de légèreté, de vanité et d’égoïsme, d’insensibilité et de froideur envers ses proches, d’instabilité et d’inconstance, de défaut de mémoire des bienfaits passés et d’ingratitude, etc.4. Or, sous ces vices apparents, se cachent ce que l’on peut nommer les « vertus libérales ».
Il faut s’arrêter à deux traits de caractère « matriciels » revendiqués par Montaigne. Tout d’abord sa profession d’indifférence relative vis-à-vis de la société et de mépris des charges publiques. Montaigne confesse volontiers être incapable d’amitiés superficielles, c’est-à-dire celles même qui forment le tissu social, selon la vision classique de la philia politikè. Il présente aux autres un visage d’arrogance, en paraissant dédaigneux ou indifférent. Il se vante, en particulier, de n’être en dette vis-à-vis de personne : « J’ay prins à haine mortelle d’estre tenu ny à autre ny par autre que moy » (III, 9, p. 969).
Cette attitude d’indifférence, voire de retrait, participe sans doute d’une forme de frustration. Montaigne aurait sans doute aimé associer vie privée et une vie sociale : « Ma forme essentielle est propre à la communication et à la production : je suis tout au dehors et en evidence, nay à la societé et à l’amitié » (II, 3, « Des trois commerces », p. 823) ; « J’aime la vie privée parce que c’est par choix que je l’aime, non par disconvenance à la vie publique (autant selon ma complexion) » (III, 9, p. 988). Les temps n’ont pas permis d’atteindre cet équilibre. Dans les conflits civils, ceux qui font profession de civisme ou de souci des autres sont en général des hypocrites, qui poursuivent leur profit privé tout en se justifiant par de belles paroles. De même que, au début de l’« Apologie de Raimond Sebond », le zèle religieux seconde « nostre pente vers la haine, la cruauté, l’ambition, l’avarice, la detraction, la rebellion » (II, 12, p. 444), le zèle civique sert de couverture à une agitation inavouable de l’esprit5.
Ceci-dit, il existe aussi des exemples sincères d’altruisme et de civisme. On en trouverait un dans le père même de Montaigne qui avait mis en pratique ces préceptes de dévouement, tant pour sa famille que pour ses administrés (« il ne fut jamais ame plus charitable et populaire »), jusqu’à y perdre la santé. Dans le chapitre « De mesnager sa volonté », Montaigne compare sa gestion de la mairie de Bordeaux avec la sienne. Ce qu’il nous dit en substance est qu’il a fait aussi bien que lui (il a lui aussi été réélu), mais avec moins de frais. Ici, ce qu’il invoque n’est pas la frustration, mais bien sa complexion : « Ce train [i.e. le dévouement aux autres], que je loue en autruy, je n’aime point à le suivre, et ne suis pas sans excuse ». La suite du texte constitue une réhabilitation de l’amitié pour soi-même et l’éloge d’une morale non-sacrificielle.
Paresse et froideur pour les grandes causes
On peut citer ici un autre groupe de traits psychologiques socialement dévalorisés, mais que Montaigne revendique. On peut nommer ces traits « acédiques » : la paresse, la mollesse, l’absence de contention d’esprit, de prévision, de remémoration, l’indifférence aux grandes causes, la versalité, etc. Là encore, Montaigne oppose à des règles éthiques convenues des traits personnels de caractère, présentant un discours normatif sous l’apparence d’une simple description psychologique en érigeant, pour reprendre l’expression d’André Tournon, « en règles les attitudes spontanées ».
Dans ces pseudo-confessions, deux aspects méritent d’être distingués, celui de l’honnête et celui de l’utile, de la vertu privée et du bien public. Du point de vue de l’honnête, ces prétendus défauts protègent celui qui les possède contre toute atteinte des maladies du temps. La « retraite » de Montaigne naît d’un sentiment d’impuissance face à la situation chaotique de l’époque : « tout crolle autour de nous » (III, 9, p. 961) ; « il est temps de nous desnouer de la societé, puis que nous n’y pouvons rien apporter » (I, 37, p. 242). De ce point de vue, les prétendus vices sont en réalité autant de moyens de libération des contraintes sociales et de gages d’autonomie.

Le chapitre II, 17, « De la praesumption », prend prétexte d’une confession, souvent amusée, de ses propres défauts, dont toute trace de repentir est singulièrement absente : « Si j’avois à revivre », poursuivra Montaigne dans le chapitre « Du repentir », « je revivrois comme j’ay vescu » (p. 816). Ce chapitre II, 17 se révèle en réalité un éloge de la liberté. Montaigne, par exemple, confesse ne pas avoir le style élégant des modèles anciens, mais la rudesse est comprise ici comme un gage de spontanéité et d’authenticité. Montaigne vieillissant ne possède plus la santé de la jeunesse, mais il a pour lui la robustesse6. Les défauts acédiques participent aussi à ce couple d’opposition : la nonchalance libère Montaigne du souci de vouloir maîtriser la fortune, ce qui demande un « soing aspre et penible » (p. 644) – « le jeu ne vaut pas la chandelle » (p. 645), précise Montaigne. Le défaut de mémoire et l’incapacité à prévoir l’exemptent de « cette nouvelle vertu de faintise et de dissimulation qui est à cet heure si fort en credit ». Montaigne précise : « de tous les vices », précise-t-il, « je n’en trouve aucun qui tesmoigne tant de lacheté et bassesse de cœur » (p. 647).
Cette mise à distance des codes moraux stoïciens, chrétiens et républicanistes aboutit à la redéfinition de la notion médiévale de « preud’homie », classiquement la vertu de l’homme « preux », faite de vaillance et de fidélité. Montaigne condamne cette « preud’homie scolastique, serve des preceptes, contraincte soubs l’esperance et la crainte », pour comprendre la preudhomie comme une vertu « qui se sente de quoy se soustenir sans aide, née en nous de ses propres racines par la semence de la raison universelle empreinte en tout homme non desnaturé » (III, 12, p. 1059). La valeur normative de la preud’homie ainsi comprise tient entièrement dans l’authenticité de l’expression libre de soi-même. Bien avant Shaftesbury, Hutchinson et Rousseau (auteurs auxquels se réfère Charles Taylor dans son ouvrage célèbre sur Les sources du moi), c’est Montaigne qui initie ce que l’on nomme aujourd’hui l’éthique de l’authenticité.
Mais ces vertus « acédiques » sont aussi réhabilitées du point de vue de l’utile. Montaigne pense que les vertus paradoxales qu’il s’attribue sont plus bénéfiques au public que les vertus stoïciennes et républicanistes dont se réclament les politiques de son temps. En se décrivant lui-même, Montaigne veut aussi montrer à ses protecteurs potentiels qu’il est l’homme de la situation : et, paradoxalement, il l’est précisément à cause de ses traits de caractère qui sont d’ordinaire compris comme des défauts en politique.
Ainsi la froideur pour les grandes causes. Si Montaigne condamne une attitude d’indifférence et de neutralité dans les guerres civiles, il reste qu’il plaide pour un engagement modéré et distant. Il soutient le parti royal et catholique, qui est « le plus sain des partis », mais, écrit-il, « je n’affecte pas qu’on me remarque specialement ennemy des autres » (III, 10, p. 1013). De fait, il ne se prive pas de reconnaître les vertus des chefs des partis opposés protestants comme ligueurs, ce qui ne manque pas de le faire passer pour un traitre à la cause (« au Gibelin j’estois Guelphe, au Guelphe Gibelin », III, 12, p. 1044). Mais, comme l’a bien montré Douglas Thompson, cette distance est aussi ce qui lui permet construire un dialogue entre les partis ennemis et de se compter parmi les hommes politiques qui préparent l’avenir post-bellum, lorsque la négociation se substituera à la violence.
La nonchalance doit être comprise dans le même sens : elle protège Montaigne de l’agitation fanatique. Et le pays a plus besoin de négociateurs prudents que de partisans exaltés. Nous avons dit que le défaut de mémoire et de prévision contraignait Montaigne à la franchise. Mais la franchise n’est pas seulement une vertu privée : elle est aussi une vertu publique. Le chapitre « De l’utile et de l’honnête » montre contre le machiavélisme ambiant, que le mensonge n’est pas toujours plus efficace que la sincérité. Comme l’a montré Philippe Desan, Montaigne s’oppose à une tradition qui a fait de l’art de l’ambassade un art de la dissimulation.
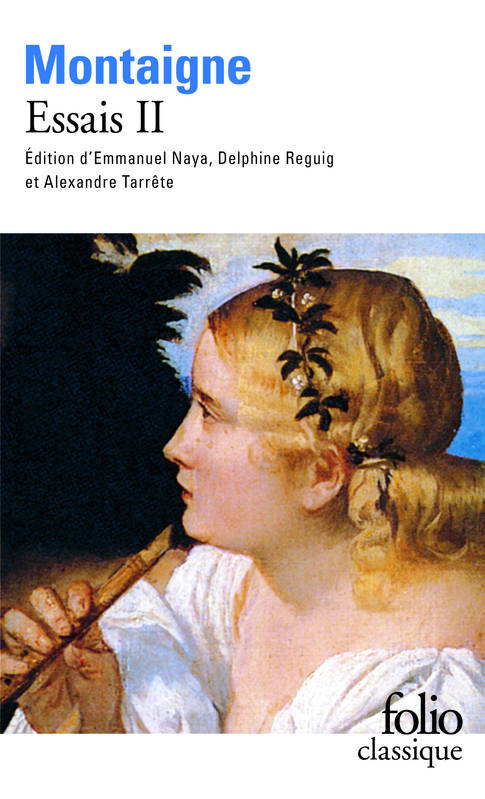
De même, l’oubli exempte des devoirs d’honneur des dettes et de respect des promesses – liens fondamentaux de toute la société féodale. Mais ce sont aussi les alliances factieuses qui se tiennent par ces réseaux de reconnaissance et d’endettement : ainsi, les édits royaux successifs de restauration de la paix s’accompagnaient-ils d’une injonction d’oubli des conflits passés.
Dans le nouveau contexte, les vertus associées à l’héroïsme civique (l’engagement, l’investissement, le dévouement sacrificiel à la cause, le courage, la fermeté, etc.) ne se révèlent pas seulement hypocrites, mais nuisibles. Montaigne a de l’admiration pour les tyrannicides, et en particulier pour Brutus, dont il admire l’intégrité, donc l’honnêteté (qui relève de l’éthique de la conviction chez Max Weber). Il reste que « les « genereux meurtriers de Caesar » (II, 10, p. 413), comme Montaigne nomme Brutus et Cassius, ont jeté « la chose publique à tel poinct qu’ils eurent à se repentir de s’en estre meslez » (III, 9, p. 958).
À l’inverse, la complexion que Montaigne décrit comme faite de mollesse, de lâcheté, de vanité et de versatilité se révèle dans le contexte social nouveau, mis à jour par les Guerres de religion, supérieure aux prétendues vertus publiques, associées au souci de la gloire et de la maîtrise de la fortune. Il y a bien ici une inversion de l’échelle républicaniste des valeurs, dont prendront acte les discours libéraux du 18e siècle qui verront, comme l’a rappelé récemment Olivier Christin, dans les héros civiques antiques des « ravageurs de la terre » (Montesquieu) et des « saccageurs de province » (Voltaire). Montaigne amorce une révolution morale, orientée vers la recherche de la paix civile, qui trouvera une expression plus systématique quelques décennies plus tard – là encore dans un contexte de conflits civils – dans l’exposé des « lois de nature » du chapitre 14 du Léviathan de Hobbes.
Il ne faut pas forcer l’opposition entre privé et public. Montaigne revendique le caractère bénéfique au public des vertus privées qu’il s’attribue. En retour, il demande que le public reconnaisse ces vertus d’authenticité. Sa description psychologique est aussi, à sa façon, une déclaration de droits qui devraient faire l’objet d’une reconnaissance publique. Ainsi, catholique en pays protestant, Montaigne pratique l’office chez lui. Il exprime aussi sa foi publiquement, voire bruyamment, en faisant résonner les cloches de sa chapelle, ce qui peut sans doute passer pour une provocation. Fort heureusement, Montaigne est aimé – et sans doute craint – de ses voisins, ce qui fait qu’il n’est pas inquiété par eux. Mais il souhaiterait que ce qu’on nommerait aujourd’hui sa « liberté d’expression » soit protégée par la loi7.
Ici, cet « égoïsme vertueux » assigne au politique sa fonction, qui est de protéger l’aspiration fondamentale de l’individu à l’expression et la reconnaissance de soi. Par ailleurs, Montaigne ne demande rien de plus à l’État. Il ne lui demande pas, en particulier, de veiller à son bonheur : « Les princes me donent prou s’ils ne m’ostent rien, et me font assez de bien quand ils ne me font point de mal ; c’est tout ce que j’en demande » (III, 9, p. 968).
Une réponse aux apories du Discours de la servitude volontaire

(1530-1563)
Les Essais constituent à ce titre une réponse aux apories du Discours de la servitude volontaire de La Boétie : comment se fait-il que nous renoncions volontairement à notre liberté pour nous faire esclaves ? Le chapitre III, 10, « De mesnager sa volonté », est une réponse presque directe à cette question. La majeure partie du livre III, écrit dans un contexte social chaotique et oppressant, et une grande partie des deux autres peuvent être lues dans cette perspective. Mais la situation que Montaigne a connue n’est pas celle de l’époque de la rédaction du Discours. C’est moins par sa volonté hégémonique que par son incurie que l’État manque à sa tâche. C’est n’est pas le pouvoir de l’« Un » que Montaigne craint, mais la puissance d’une multitude mal gouvernée. Il ne s’agit plus, comme chez La Boétie, de recouvrer la liberté républicaine face à l’arbitraire d’un régime autocratique. Montaigne considère toute autorité, qu’elle se présente sous la forme d’une contrainte physique ou d’une pression sociale comme aliénante par elle-même. La réponse, elle aussi, doit être différente de celle de La Boétie.
Montaigne inverse simplement la maladie et la thérapie, qui est non plus le courage et la virilité, mais la mollesse et la nonchalance. Le souci excessif du public n’est pas le remède, mais au contraire la cause principale de la servitude : le remède consiste en retour dans la conquête d’une sphère d’insoumission à ces contraintes. Pour La Boétie, les vertus salvatrices reposaient sur ces vertus « viriles » que sont le courage et la fermeté. Montaigne, au contraire, met en valeur des vertus qui, à son époque, sont souvent associées à la féminité, de lâcheté, de nonchalance et de versatilité.
Le but reste néanmoins le même. Il n’est peut-être jamais mieux exprimé par Montaigne que dans ce court texte en forme de boutade, qui peut avoir une résonnance nouvelle dans notre époque post-confinement :
« Je suis si affady apres la liberté, que qui me deffenderoit l’accez de quelque coin des Indes, j’en vivroys aucunement plus mal à mon aise. Et tant que je trouveray terre ou air ouvert ailleurs, je ne croupiray en lieu où il me faille cacher ». (III, 13, « De l’experience », p. 1072).
Il s’agit bien de se libérer de toutes formes de contraintes, quelles que soient la finalité qui y préside (Montaigne ne mentionne pas le « pourquoi » d’une telle interdiction) et quand bien même celles-ci ne m’interdiraient que ce que je n’ai ni le pouvoir, ni peut-être la volonté de faire (Hobbes distinguera plus nettement liberty et power), pour affirmer son autonomie au-delà des codes sociaux et des lois (ici par une évasion dans le voyage). Il s’agit bien ici d’une préfiguration de la « liberté des modernes » défendue par Benjamin Constant contre les « imitateurs modernes des républiques de l’Antiquité », ou encore de la liberté négative, dans laquelle Isaiah Berlin verra l’une des aspirations fondamentales et irréductibles de l’âme humaine.

Thierry Gontier
Professeur de philosophie politique et morale – Université Jean Moulin – Lyon 3, Doyen de la Faculté de philosophie, membre honoraire de l’Institut universitaire de France. Ses travaux portent sur l’anthropologie dans la philosophie moderne (XVe-XVIIe siècles) et sa réception dans la philosophie contemporaine. Vient de publier L’égoïsme vertueux Montaigne et la formation de l’esprit libéral (Belles-Lettres 2023)
Notes
| ↑1 | Et aussi : « Qui oublieroit de bien et saintement vivre, et penseroit estre quite de son devoir en y acheminant et dressant les autres, ce seroit un sot; tout de mesme, qui abandonne en son propre le sainement et gayement vivre pour en servir autruy, prent à mon gré un mauvais et desnaturé parti » ; « Je ne veux pas qu’on refuse aux charges qu’on prend l’attention, les pas, les parolles, et la sueur et le sang au besoin […]. Mais c’est par emprunt et accidentellement ». |
|---|---|
| ↑2 | À l’époque même de Montaigne, on peut citer, outre les pamphlets protestants, les traités de Pierre de la Place (1578), de Guillaume de La Perrière, de Jean Bodin ou de Pierre de La Primaudaye (1577) – liste ici reprise de Constance Jordan |
| ↑3 | On se réfèrera ici aux travaux d’Arlette Jouanna sur le Devoir de révolte. |
| ↑4 | Le chapitre II, 17, « De la praesumption », constitue ainsi un exposé ordonné par Montaigne de ces vices retournés en vertus, mais on pourrait aussi citer le chapitre III, 9, « De la vanité », dans lequel Montaigne fait une vertu de son inconstance et de son peu de souci du public. |
| ↑5 | « Quant à ce beau mot dequoy se couvre l’ambition et l’avarice : Que nous ne sommes pas nez pour nostre particulier, ains pour le publicq, rapportons nous en hardiment à ceux qui sont en la danse ; et qu’ils se battent la conscience, si, au rebours, les estats, les charges, et cette tracasserie du monde ne se recherche plutost pour tirer du publicq son profit particulier. Les mauvais moyens par où on s’y pousse en nostre siecle, montrent bien que la fin n’en vaut gueres » (I, 39, De la solitude », p. 237). Il ne faut pas appeller devoir (comme nous faisons tous les jours) une aigreur et aspreté intestine qui naist de l’interest et passion privée ; ny courage, une conduitte traistresse et malitieuse. Ils nomment zele leur propension vers la malignité et violence : ce n’est pas la cause qui les eschauffe, c’est leur interest ; ils attisent la guerre non par ce qu’elle est juste, mais par ce que c’est guerre. » (III, 1, « De l’utile et de l’honneste », p. 793-794). |
| ↑6 | « Je dure bien à la peine ; mais j’y dure, si me porte moy-mesme, et autant que mon desir m’y conduit. » (II, 17, p. 642). |
| ↑7 | « J’eschape ; mais il me desplait que ce soit plus par fortune, voire et par ma prudence, que par justice, et me desplaist d’estre hors la protection des loix et soubs autre sauvegarde que la leur. Comme les choses sont, je vis plus qu’à demy de la faveur d’autruy, qui est une rude obligation. Je ne veux debvoir ma seureté, ny à la bonté et benignité des grands, qui s’aggréent de ma legalité et liberté, ny à la facilité des meurs de mes predecesseurs et miennes. Car quoy, si j’estois autre ? […] je tiens qu’il faut vivre par droict et par auctorité, non par recompence ny par grace. » (III, 9, p. 966). |