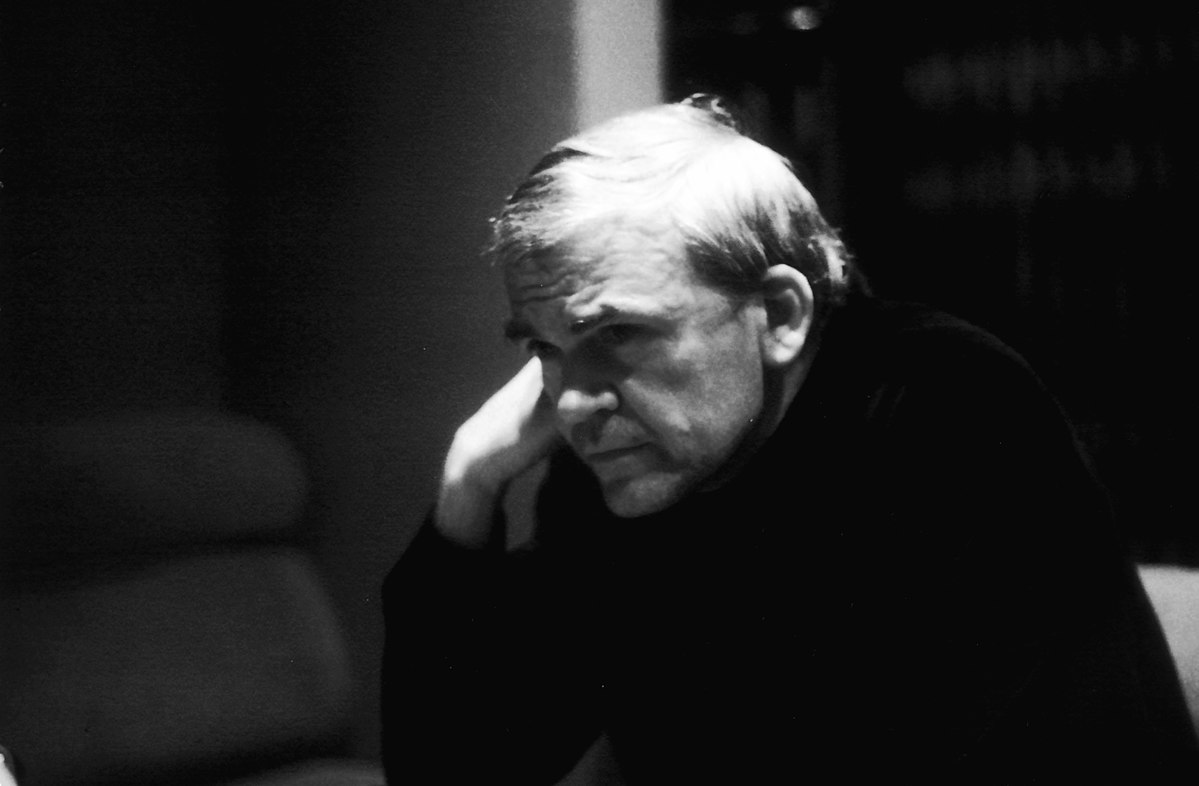
Les réactions à la mort de Milan Kundera en France et en République tchèque ne sont pas sans créer une forme de dissonance cognitive. D’ordinaire, les intellectuels français pontifient sur la littérature et la politique d’Europe centrale en comprenant bien peu à l’Europe centrale en général et à la République tchèque en particulier. Cette fois-ci, c’est presque le contraire : non seulement les Français ont leur propre compréhension et interprétation de la vie et de la mort de Kundera, mais celle-ci est pleinement légitime, aussi légitime que celle des Tchèques. Reste que les deux parties ignorent les problématiques sous-jacentes et les sous-entendus qui prévalent dans l’autre pays. C’est un peu comme si certains Français aimaient Kundera pour les mauvaises raisons, et certains Tchèques ne l’aimaient pas pour de mauvaises raisons aussi.
Le premier malentendu : ce que signifie être français
La source d’un premier malentendu réside dans le fait que, contrairement à la plus grande partie de la société tchèque, Kundera n’a pas seulement compris le caractère universaliste de la culture française, il l’a délibérément adopté. Il a choisi de s’installer en France et de devenir un écrivain français. Cette décision a naturellement été attribuée à des motifs politiques dans le contexte du régime étouffant dit de normalisation des années 1970 en Tchécoslovaquie, mais il serait erroné de négliger l’aspect esthétique de cette position car elle révèle un monde d’idées fausses de part et d’autre.

Pour la plupart des Tchèques, il est en effet incompréhensible de s’éloigner non seulement de la mère-patrie, mais aussi de la nation tchèque. La culture et l’identité tchèques, inscrites dans la sphère civilisationnelle germanophone, sont fondées sur un ethno-nationalisme inspiré de Herder et Fichte : dans cet idéal-type, est tchèque celui qui est né de parents tchèques, point final. Le fait que Kundera eût émigré sous le communisme fut ressenti comme une petite trahison dans son pays, mais était compréhensible dans le contexte politique de l’époque ; que Kundera, Škvorecký, Kohout et d’autres soient « devenus étrangers » et aient refusé de revenir après 1989 est rapidement devenu impardonnable, surtout s’ils étaient critiques à l’égard du régime post-communiste.
Au moins un courant de la conception française de la nation et de l’identité est plus proche de la conception américaine : dans cet idéal-type (certes parfois éloigné de la réalité pratique), est français celui qui veut être Français, qui est né en France ou s’est installé en France, et qui promeut, par l’usage de la langue française (peu importe son accent), des idées, des valeurs et une esthétique qui prétendent s’adresser à l’ensemble du monde. Les Français sont souvent considérés à tort comme nationalistes parce qu’ils entendent parler au nom du monde entier ; du point de vue français, cette attitude est au contraire l’inverse du nationalisme puisqu’il s’agit de promouvoir des valeurs universelles (du moins en théorie). Le fait que la sphère intellectuelle française fût, à l’époque de l’arrivée de Kundera, marquée à gauche, avec un intérêt durable pour le communisme tchécoslovaque (par exemple pour Eugen Fried et Artur London), et que Kundera fût un communiste tchèque désabusé, mais qui avait encore des penchants pour les idéaux non-communistes de gauche, a ajouté à la spontanéité et au caractère naturel de ce transfert culturel.
Kundera avait bien compris ces éléments et fut accueilli à Paris à bras ouverts. La France a accepté avec délectation le cadeau de la présence littéraire de Kundera et l’a facilement intégré à la nation française, non pas en dépit du fait qu’il fût tchèque, mais parce qu’il était tchèque. En échange, Kundera a obtenu ce qu’il désirait le plus : une formidable opportunité de s’adresser au monde entier par le biais de son œuvre littéraire, et ce depuis Paris, qui jouissait encore d’un cachet intellectuel considérable. Il n’a accepté la restitution de son passeport tchèque que lorsque celui-ci lui a été littéralement apporté sur un plateau en 2019 par le premier ministre Andrej Babiš1.
Il ne fait aucun doute que le principal objectif de Kundera était de veiller à la qualité de sa production littéraire. Il modifia ses romans tchèques en français, non pas pour réécrire l’histoire, mais pour s’adresser à un public toujours plus large. Il adopta le français comme nouvelle langue littéraire pour être mieux compris dans le monde. Il a refusé jusqu’à récemment que ses romans français soient même traduits en tchèque. Il s’est retiré de toute apparition publique afin d’être aussi détaché que possible de la politique, afin que seule la valeur littéraire de son œuvre demeure au centre de l’attention. Il a jalousement gardé et contrôlé chaque mot écrit qu’il ait jamais produit. Certains experts tchèques s’en sont amèrement moqués, mais ils n’ont pas compris le raisonnement de Kundera : pour lui, être écrivain était plus important qu’être tchèque ; il se trouve qu’être écrivain était aussi une façon intrinsèque d’être français. C’était une situation donnant-donnant.
Le deuxième malentendu : ce que signifie être tchèque
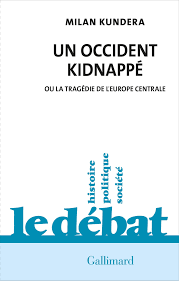
Cet effacement progressif des engagements politiques et intellectuels au profit de la littérature ne s’est pas fait sans heurts ni revers, ni surtout sans ironie amère. Sur le chemin de la francité et de l’universalisme abstrait, Kundera publiait en 1983 son célèbre essai Un Occident kidnappé ou La tragédie de l’Europe centrale. C’est peu dire que les intellectuels français l’ont aimé : ils l’ont vénéré. Tout l’Occident l’a adoré. A quelques années d’écart, je l’adorais aussi et j’étais impatiente de découvrir cette magnifique culture d’Europe centrale. Étudiante à Paris, de surcroît étudiante de Jacques Rupnik, je me martelais la vérité historique de l’époque
Pourtant, je me permettrai ici de soutenir que Kundera s’est fondamentalement trompé dans cet essai, et qu’il a faussé la réflexion intellectuelle sur les liens culturels entre les Europe occidentale et centrale pour des décennies. L’article était erroné sur au moins deux points. Tout d’abord, le concept de nation, petite ou grande, est une construction intellectuelle. Comme l’a souligné Benedict Anderson dans son célèbre ouvrage publié la même année, en 1983, la nation est une « communauté imaginaire. » La perception est évidemment plus importante que la réalité, mais elle peut la déformer jusqu’à l’absurde. Les Tchèques comptent 10,5 millions d’habitants – il n’y a aucune raison qu’ils se sentent « petits » alors même qu’il n’y a que 5 millions de Slovaques, 2 millions de Slovènes ou moins d’un million d’Estoniens. Les Polonais comptent 40 millions d’habitants, mais ils se sentent aussi « petits » que les Tchèques, c’est-à-dire victimes de l’histoire et brimés par leurs grands voisins, l’Allemagne et la Russie. Au contraire, les Hongrois sont un peu moins de 10 millions, mais se sont toujours considérés comme une grande nation, destinée à régner sur les autres (l’histoire en a décidé autrement, car l’histoire est injuste). Les Autrichiens ne sont que 9 millions, mais ils ont dirigé un empire pendant des siècles. Pourtant, ils réfléchissent à leur position dans le monde et à leur culture de façon très comparable à celle des Tchèques. Les mémoires de Stefan Zweig, Le monde d’hier, sont à cet égard éloquents : ils décrivent la vie intellectuelle viennoise, mais Zweig pourrait tout aussi bien parler de Prague. Les petites nations ont peut-être été malmenées par leurs voisins au cours de l’histoire, mais il serait ridicule de prétendre que les grands États ne l’ont pas été tout autant.

La mise en avant du mythe des petites nations d’Europe centrale était en réalité destinée à un public occidental, à l’instar de l’ouvrage de l’intellectuel hongrois István Bibó intitulé Misère des petits États d’Europe de l’Est. S’il n’est guère pertinent sur l’Europe centrale, l’essai en dit en revanche long sur le narcissisme et l’orientalisme des grands États occidentaux de l’époque, en particulier de la France et de la Grande-Bretagne, trop heureux d’apparaître, par contraste avec ces rejetons condamnés de la modernité, grands et puissants. L’épisode de I’Occident kidnappé a définitivement ancré la position de Kundera non pas en tant que Tchèque, mais en tant qu’intellectuel français, ce qui en était sans nul doute l’objectif.
La deuxième raison pour laquelle l’essai de Kundera était imparfait est qu’il a éludé les responsabilités tchèques et slovaques dans l’instauration et la stabilisation du régime communiste. Loin de moi l’idée de disculper les Soviétiques de leurs responsabilités et de la dévastation humaine et économique qu’ils ont fait subir à l’Europe centrale de 1945 à 1989. La question ici est plutôt de savoir s’ils en sont les seuls responsables. Incriminer Staline et « les Russes » était un argument typique du Printemps de Prague avant même l’occupation du pays par les troupes du Pacte de Varsovie en août. Pourquoi accuser les Russes au printemps 1968, alors même que le communisme avait acquis un niveau de popularité historique en Tchécoslovaquie et qu’il avait finalement réussi à fusionner le socialisme et la démocratie ? Parce que le pays n’avait pas réussi à s’opposer au stalinisme et avait manqué un grand rendez-vous de l’histoire, le soulèvement des nations d’Europe centrale contre la tyrannie en 1956. Pour une société qui se prétendait culturellement démocratique, il était difficile de justifier le fait que la Tchécoslovaquie n’eût pas rejoint les Polonais et les Hongrois dans leur courageuse opposition à l’URSS. Bien au contraire, la Tchécoslovaquie avait fait tout ce qu’elle était en mesure de faire pour briser la rébellion de ses voisins et aider Khrouchtchev à les soumettre. L’explication de ce comportement inattendu, comme je l’ai montré ici en français et ici en tchèque, est assez prosaïque : contrairement à la Hongrie et à la Pologne, la Tchécoslovaquie s’inscrivait dans une longue tradition culturelle de gauche, de sorte que le communisme avait des racines profondes et solides ; et contrairement à eux, la Tchécoslovaquie était un pays développé et industrialisé et son niveau de vie restait supportable même après le stalinisme, encore comparable à bien des égards à celui des pays d’Europe de l’Ouest.

Mais vu de 1968, cette approbation précoce de la dictature stalinienne était devenue gênante. De nouvelles thèses historiques furent inventées de toutes pièces pour démontrer que si la Tchécoslovaquie ne s’était pas rebellée pendant la déstalinisation, malgré sa culture démocratique, c’est uniquement parce qu’elle était encore anesthésiée par la terreur, une terreur plus forte que celle de tous les autres pays communistes réunis. J’ai souligné ailleurs que la Tchécoslovaquie n’avait pas souffert de la terreur plus que tous les autres pays réunis, voire qu’elle avait peut-être moins souffert de la terreur que n’importe lequel des autres pays communistes pris individuellement, même si, encore une fois, il ne s’agit absolument pas de nier que la terreur a existé et qu’elle a fait des victimes. La moindre dimension de la terreur collective tchécoslovaque par rapport à d’autres pays, si elle est confirmée, ne dévalorise en rien la souffrance des victimes individuelles. Mais quel que soit le manque de fondement de cette thèse historique d’une « plus grande terreur », le monde entier est resté ébloui par le Printemps de Prague.
Le Printemps de Prague a donc été, à bien des égards, la tentative d’hommes d’âge moyen de justifier leur soutien enthousiaste, en tant que jeunes intellectuels communistes, au régime de terreur du début des années 1950. Kundera appartenait exactement à cette génération. Au lieu de se confronter au niveau inquiétant de collaboration du régime avec les Soviétiques et au niveau troublant de collaboration de la population avec le régime, au lieu de réfléchir à l’aisance avec laquelle une société développée avait pu se soumettre à la dictature, un nouveau coupable, « Staline et les Russes », avait été trouvé. Comme l’on pouvait s’y attendre, l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie le 21 août 1968 ne fit ensuite que graver cette explication dans le marbre. Les « Russes » étaient réaffirmés comme les seuls coupables, et les Tchèques s’épargnèrent une réflexion douloureuse sur leur collaboration passée et présente avec le régime post-invasion soutenu par les Soviétiques.

L’Occident kidnappé de Kundera n’est donc pas surgi de nulle part, mais faisait partie de son bagage intellectuel de long terme. En 1968 déjà, dans le cadre d’un débat provoqué par un autre de ses essais brillamment provocateurs, cette fois sur le destin tchèque dans l’histoire, un jeune intellectuel du nom de Václav Havel lui avait reproché son pathos et sa compréhension romantique de la contribution tchèque au monde des idées (de gauche). Le public français n’était absolument pas en mesure de saisir ces références subtiles de l’Occident kidnappé, mais ainsi que je l’ai expliqué plus haut, cela n’avait guère d’importance dans la mesure où l’objectif était ailleurs : il s’agissait de faire de Kundera un intellectuel français, sur un fond implicite de soutien partagé à des idéaux de gauche modérés. Par ailleurs, l’essai L’Occident kidnappé peut être rétrospectivement lu comme ouvrant la voie à des sous-entendus civilisationnels qui suggéraient déjà un futur récit néo-conservateur à la Samuel Huntington – et plus prosaïquement, en Europe, à un virage conservateur de la gauche après 1989.
Ce qui est marquant est que Kundera a contribué à détourner la nation tchèque de tout examen de sa collaboration avec le régime communiste en tant que pratique sociale et problème historique, du moins à un niveau collectif. Les personnages de Kundera dans La plaisanterie, La vie est ailleurs, L’insoutenable légèreté de l’être ou Le livre du rire et de l’oubli sont bien confrontés à la question du communisme comme caution endogène de la dictature et de la trahison morale, mais seulement à une échelle individuelle, comme une leçon de morale à laquelle tout un chacun pouvait s’identifier dans ce qui était, encore une fois, une recherche de l’universalité. Certes, c’était le rôle de Kundera en tant qu’écrivain que de transposer en littérature des questions sociétales douloureuses. Mais le rôle de Kundera en tant qu’intellectuel public se retrouva quelque peu en contradiction avec l’esthétique de cette prise en charge individuelle de la répression dans sa réalité quotidienne.
Le débat sur l’Occident kidnappé
De fait, une suite inattendue au débat sur l’Occident kidnappé allait revenir hanter Kundera et ce d’autant plus cruellement que, bien qu’il ait perdu son débat avec Havel en 1968 (ou du moins c’est ce que les observateurs avaient estimé à l’époque), Kundera a involontairement gagné la partie anti-russe de la bataille post-communiste : plus la Révolution de velours de 1989 s’éloigne, plus l’État tchèque réécrit l’histoire du communisme tchécoslovaque sous la forme d’un héroïsme anti-communiste écrasé par la domination soviétique. Puisque les malheurs du communisme et donc du post-communisme sont aujourd’hui commodément imputés aux Russes et à leurs agents communistes tchécoslovaques, la recherche historique sur la collaboration des Tchèques ordinaires avec le régime communiste n’est pas seulement malvenue, elle est presque illégale. La loi créant l’Institut pour l’étude des régimes totalitaires de 2007 a énuméré les thèmes de recherche que cet institut national de la mémoire devait poursuivre : la résistance, et la répression – mais pas la collaboration en tant que pratique sociale.

Pourtant, en 2008 et sous couvert de recherches sur la résistance anticommuniste, le responsable du département d’histoire orale de cet institut, Adam Hradilek, publiait avec le journaliste Petr Třešňák ce qui se voulait une découverte sensationnelle : en 1950, Kundera aurait signalé à la police la présence d’un inconnu qui était apparu dans la résidence universitaire dont il était l’étudiant responsable. J’ai déjà largement écrit sur cette affaire (ici en français, et ici en tchèque), je me contenterai donc de la résumer : un natif tchèque, résistant anticommuniste, s’était enfui à l’Ouest et avait été chargé par les forces exilées tchèques, soutenues par les Américains en Bavière, de retourner sur place et d’essayer de constituer un réseau de résistance clandestine. Miroslav Dvořáček, c’était son nom, retraversa la frontière tchécoslovaque, fut hébergé par de généreux inconnus, rencontra par hasard dans la rue une ancienne amie, Iva Militká, lui demanda de garder sa valise dans son dortoir d’étudiante, et poursuivit la mise en place de son réseau clandestin en recherchant le numéro de son contact potentiel dans l’annuaire téléphonique local. Ne le trouvant pas et ne sachant que faire d’autre, il retourna chercher sa valise et fut arrêté sur place, Milan Kundera ayant déjà alerté la police sur sa présence – c’est du moins ce qu’affirment Hradilek et Třešňák. Un document de police rapporte en effet qu’un certain Milan Kundera, né le 1er avril 1929, était passé signaler la présence de Dvořáček, ou peut-être seulement de sa valise, bien que le document ne soit pas signé, ce qui est bien entendu un point capital.
Le scandale international qui a suivi cette « révélation » a avalé ce récit sans broncher et condamné Kundera avant même de s’interroger sur le sérieux de ce travail historique. Il s’agissait pourtant d’un niveau de recherche déplorable qui jette le discrédit sur la profession même d’historien et de journaliste. L’article était un réquisitoire et non une réflexion historique. Poussés par leur récit anticommuniste et peut-être par leur goût du sensationnel, Hradilek et Třešňák n’ont pas restitué le contexte et ont négligé de nombreux détails cruciaux. J’ai été cependant surprise de lire dans les différentes nécrologies qui ont suivi la mort de Kundera ces derniers jours, en particulier en France, que leur accusation s’était révélée fausse. Ceci est inexact. Aucune preuve documentaire n’a été produite depuis 2008 pour la démentir. Compte tenu du contexte historique, il est à mon avis effectivement possible et même probable que Kundera ait dénoncé Dvořáček à la police. Mais là n’est pas la question. La question est que Kundera n’avait pas d’autre choix et que s’il n’avait pas dénoncé Dvořáček lui-même, quelqu’un d’autre l’aurait fait, et ce, le jour même. En fait, l’indiscrétion de Kundera, si elle était bien sienne, est arrivée en troisième position ce jour-ci. Reprenons le contexte qui manquait dans l’article.
Milan Kundera venait d’être exclu du parti communiste et il était l’étudiant responsable du dortoir Kolonka, autant dire qu’il était à la merci du régime. La police surveillait le dortoir pour d’autres raisons – elle était à la recherche d’un meurtrier, dont elle pensait qu’il pourrait y cacher une valise – et les étudiants avaient été alertés sur la nécessité de signaler tout événement suspect. Et pour couronner le tout, la police secrète avait organisé une série de provocations au cours des mois précédents, se faisant passer pour des résistants revenant de l’Ouest, pour ensuite démasquer et arrêter tout sympathisant anticommuniste. Il aurait été suicidaire pour Kundera comme pour tout autre étudiant averti de la présence de Dvořáček ce jour-là de ne pas le signaler immédiatement.
Morale de l’histoire
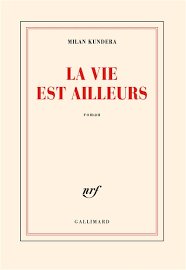
Reprenons donc la chaîne des responsabilités : les forces tchèques en Allemagne et les Américains avaient fait preuve d’une bêtise presque criminelle en renvoyant des espions en herbe sans formation adéquate dans une dictature étroitement surveillée – ce n’est pas seulement Miroslav Dvořáček, mais aussi son compagnon d’armes Juppa qui fut arrêté dès le premier jour de leur mission. C’était d’un amateurisme tragique pour Dvořáček que de chercher ses contacts top secrets dans l’annuaire téléphonique et de confier son destin à une ancienne amie dont il ne savait rien en l’état actuel des choses. Il était irresponsable de la part d’Iva Militká de raconter toute l’histoire à son petit ami, Miroslav Dlask. Il était rationnel mais moralement douteux pour Dlask de rapporter l’histoire à Kundera, soit pour protéger sa petite amie, soit parce qu’il était jaloux qu’un autre homme puisse dormir dans sa chambre, soit les deux. Incidemment, après l’éclatement du scandale en 2008, un nouveau témoin, un ancien policier, a affirmé que Dlask aussi était allé dénoncer Dvořáček à la police, indépendamment de Kundera ou peut-être même à sa place ou en son nom, ce qui expliquerait l’absence de sa signature. Il n’était pas particulièrement glorieux de la part de Kundera de rapporter l’information à la police s’il l’a fait, mais encore une fois, pas surprenant non plus et un geste de survie bien compréhensible. Il n’était pas particulièrement glorieux non plus pour Dvořáček lui-même de finir par dénoncer, lors d’un interrogatoire de police, les généreux étrangers qui l’avaient hébergé lors de sa première nuit. Il n’était pas d’une grande noblesse de caractère de la part d’Iva Militká, qui avait été assez stupide pour parler de Dvořáček à son petit ami, que d’envoyer le membre de sa famille Hradilek sur les traces de cette histoire uniquement pour apaiser sa propre conscience et apprendre le dernier mot sur le comportement de son petit ami de l’époque, devenu son mari, Miroslav Dlask, qui était décédé entre-temps. Enfin, Hradilek et Třešňák ont singulièrement manqué de professionnalisme en se satisfaisant de cette découverte, qui se voulait sensationnelle, sans prendre la peine de restituer le contexte ou de donner la parole à Kundera.
La morale de cette histoire est que presque tout le monde finit par parler lorsqu’il est torturé ou soumis à la pression de la police secrète dans un régime de terreur. Il n’est pas surprenant que Kundera ait nié avoir fait un rapport sur Dvořáček : même s’il l’a fait, ce qui n’est pas certain, se souviendrait-il de cet épisode alors même qu’il n’avait aucune idée de qui était Dvořáček et de la manière dont l’histoire a fatidiquement poursuivi son cours pour lui ? Ce qui est tragique est non seulement le sort de Dvořáček, qui a survécu à son arrestation mais a subi un terrible séjour de presque quinze ans en camp de travail et en prison, mais aussi celui de Kundera, qui s’est retrouvé traîné dans la boue par la presse internationale sans aucune possibilité de se défendre.
L’ironie de cette histoire, comme je l’ai souligné plus haut, est que Kundera n’avait lui-même pas peu contribué, en tant qu’intellectuel public, à dispenser son pays de tout débat sur la collaboration. Pourtant, ce qui est arrivé à Dvořáček n’était pas la faute des « Russes », mais bien celle de civils tchèques. En tant qu’écrivain accompli, Kundera n’avait pas manqué de réfléchir sur le plan littéraire à ce que nous voyons lorsque nous regardons dans le miroir (pensons à son alter ego Jaromil dans La vie est ailleurs), mais en tant qu’intellectuel public, il a curieusement omis de réfléchir à cet aspect inopportun de l’oubli collectif. Quant à nous, le public, plus d’empathie aurait été la bienvenue : rien ne nous empêche de compatir à la fois au destin de Dvořáček et à celui de Kundera.
La cruelle ironie du sort
En 1968, il avait été invraisemblable de voir communistes réformateurs et démocrates s’accorder tout à coup sur le fait que la culture tchèque était intrinsèquement démocratique, c’est-à-dire occidentale, y compris au sein du Parti communiste de Tchécoslovaquie. Le seul problème, clamaient les intellectuels du Printemps de Prague, c’est que cette culture avait été pervertie par Staline au sein même du parti.
Par l’un de ces paradoxes imprévisibles de l’histoire, la thèse de l’Occident kidnappé a été involontairement ravivée par les doctrinaires anticommunistes d’après-1989, des personnalités qui ne sont pas sans rappeler les doctrinaires staliniens de la fin des années 1940 et du début des années 1950. Aujourd’hui à nouveau, mais pour des raisons qui vont maintenant à l’encontre de la mauvaise conscience de Kundera et de sa génération à l’égard du stalinisme, la destruction de ce que l’on estime avoir été une culture démocratique tchèque après 1948 est entièrement attribuée aux Russes ou plus exactement, comme il est plus politiquement correct de le dire de nos jours, aux Soviétiques. Mais pas seulement aux Soviétiques : à leurs alliés tchécoslovaques aussi, les communistes de l’époque, c’est-à-dire comprenant désormais Kundera lui-même. La nouvelle idéologie anticommuniste est donc la sœur jumelle de l’ancienne idéologie communiste, et Kundera s’est retrouvé pris dans les deux, la première fois en tant que co-créateur de ce piège intellectuel, la seconde fois en tant que personne qui y a été poussée.
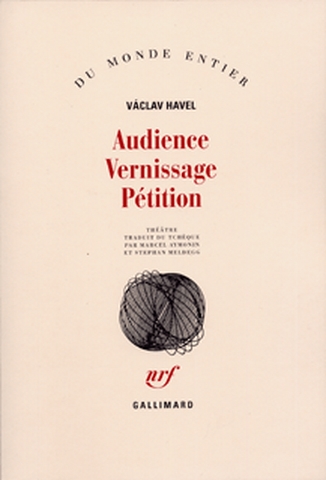
Havel et Kundera sont deux des rares intellectuels tchèques capables de penser en termes abstraits et universels. Tous deux eurent du mal à se faire comprendre du public tchèque, ce qui montre qu’il n’est pas facile d’être patriote tchèque tout en étant ouvert sur le monde. Milan Kundera ne méritait vraiment pas l’opprobre qui l’a frappé dans ses quinze dernières années. Ce qu’il aurait mérité, c’était le prix Nobel de littérature, tout comme Havel aurait mérité le prix Nobel de la paix. Le fait que ni l’un ni l’autre ne l’ait reçu est certainement une injustice historique. Pour être honnête, après avoir intensément étudié la culture tchèque vue de Paris, la société tchèque que j’ai rencontrée en 1990 était plus proche des récits terre-à-terre de Vaculík et Škvorecký, y compris dans leur vulgarité et sexisme ordinaires, que de Havel et Kundera, qui évoluaient dans un univers intellectuel de haut vol. Tous quatre étaient au moins unis par ce que Kundera a souligné à juste titre comme étant une qualité tchèque proverbiale : un délicieux sens de l’humour. Mais ces deux géants ont écrit certains des essais les plus productifs de notre époque et ils étaient profondément européens et humains. Comme le montrent les hommages émouvants rendus aux quatre coins du monde, nous nous sommes tous appropriés Kundera, à l’est comme à l’ouest. Ne serait-ce qu’à ce titre, il restera comme un romancier brillant et universel.

Muriel Blaive
Merci à Derek Sayer, Gérard-Daniel Cohen, Ruth Zylberman, Jan Čulík et Eloïse Adde pour leurs remarques critiques.
Une première version de cet article a paru en anglais et en tchèque, le 22 juillet 2023, dans la revue Britské listy.
Muriel Blaive, historienne, vit à Vienne. Elle est l’auteur de nombreux articles sur l’Europe centrale, et est actuellement rattachée à l’université de Graz au travers d’un projet de recherche du programme Elise Richter sur la confrontation de la société tchèque à son passé.
Notes
| ↑1 | Ce fut d’ailleurs le seul geste noble de tout le mandat de Babiš, peut-être parce que Babiš lui-même est une bizarrerie : il n’est pas né tchèque. |
|---|