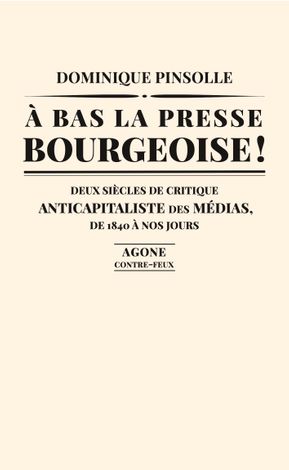
L’ouvrage de Dominique Pinsolle, professeur d’histoire à l’Université de Bordeaux, consacré à ce qu’il appelle la « critique anticapitaliste » des médias, mérite la lecture pour plusieurs raisons. C’est tout d’abord une synthèse utile des grands travaux sur l’histoire de la presse française, qui fait fonds sur les ouvrages de Jean-Yves Mollier et de Marc Martin, entre beaucoup d’autres (tous dûment cités en bibliographie), pour donner en deux cents pages ce qu’ont été les grandes étapes économiques et politiques du secteur. Mais c’est aussi une bonne illustration de ce que cet « anticapitalisme » sait voir et continue d’ignorer dès qu’il s’agit de réforme des médias et de promotion d’une presse de qualité.
Histoires
Tout commence pour notre époque, rappelle-t-il, dans la deuxième partie du règne de Louis-Philippe, par le lancement de journaux qui se financent, non plus seulement par le lectorat et les abonnés, mais par la publicité commerciale. C’est le moyen, pour les nouvelles générations d’entrepreneurs, Emile de Girardin au premier chef, de résoudre une difficulté à laquelle la Presse est confrontée comme par nature : la lourdeur des investissements à effectuer, et l’impossibilité de faire payer au lecteur le vrai prix des journaux, surtout à cette époque où le niveau de vie de la majeure partie de la population reste peu élevé. La presse est une industrie capitalistique, et les coûts fixes sont comme une malédiction ! L’équation économique est posée dès cette époque, et ses termes n’ont pas vraiment changé, ajouterons-nous. Même les nouveaux capitalistes de l’internet, à la tête du Washington Post par exemple, ont du mal à la résoudre, nous dit le Guardian.
Ces nouveaux journaux s’attirent la réprobation des esprits cultivés. « Une critique conservatrice de la presse commerciale se développe, défendant avec nostalgie un modèle élitiste dont la fin semble proche. » Comme Balzac, Sainte-Beuve critique aussi la « littérature industrielle » qui parait dans « la presse dite à quarante francs », encensée par des critiques complaisants, stipendiés. Si le socialisme naissant, Louis Blanc par exemple, reconnait l’intérêt de toucher les classes laborieuses, il est tout aussi critique devant la dégradation morale qui vient de la combinaison du journalisme, qui n’est plus un « sacerdoce », et de la réclame. Pour autant le socialisme s’associe à la lutte des milieux libéraux contre la censure, celle de l’Etat, la seule qu’on envisageait à l’époque. Cette première critique anticapitaliste des médias en reste à la réprobation morale, et n’imagine pas encore quelles solutions institutionnelles permettraient de résoudre l’équation économique qui se pose à tout journal.
Dès que l’ordre social est remis en cause, avec les journées de juin 1848, les milieux libéraux en reviennent rapidement au contrôle administratif de la presse et aux sanctions judiciaires. Le Second Empire n’arrangera rien. C’est durant cette période de liberté très mesurée que la presse commerciale se développe, et rarement pour le meilleur. C’est l’époque, rappelle Dominique Pinsolle, où la presse financière participe à toutes les manipulations boursières dans une France qui s’industrialise, et cette mauvaise habitude ne disparaitra qu’après la Seconde Guerre Mondiale (encore que…). Le capitalisme de presse prend son essor, et les journaux s’avèrent des affaires très rentables malgré les importants capitaux qu’il faut investir.
La IIIème République veut en finir avec la censure politique, et le Parlement vote la grande loi de libéralisation du 29 juillet 1881, toujours en vigueur, qui pour l’essentiel fait disparaître le contrôle administratif préalable et circonscrit au minimum les « délits de presse », i.e. ce que l’on peut reprocher aux journaux devant les tribunaux correctionnels. Mais elle ne modifie en rien les cadres institutionnels, et le capitalisme de presse non seulement se maintient mais gagne en force, grâce aux tirages de plus en plus élevés, au prix de la publicité qui augmente dans un pays qui s’enrichit. Pour reprendre les mots de Dominique Pinsolle, la presse s’est affranchie de l’Etat, mais non des spéculateurs. Dans l’Entre-Deux-Guerres, les tendances anciennes se prolongent, mais dans un contexte moins favorable à la prospérité économique des journaux, et notamment à celle des quotidiens. C’est aussi le moment des premières grandes grèves de la presse, face à un patronat qui se raidit. La corruption tend surtout à se généraliser, si bien qu’à la Libération la presse établie est totalement déconsidérée1
Dès la Belle Epoque, les milieux socialistes s’en étaient alarmés et étaient allés au-delà de la réprobation morale, d’autant que Commune avait montré que les grands journaux prenaient le parti des Versaillais sans souci de neutralité politique. Certains syndicalistes préconisent alors de n’avoir plus de rapport avec les journalistes de la presse bourgeoise, trop hostile aux intérêts ouvriers, biaisée. Georges Renard, ancien Communard, propose la création d’un syndicat de journalistes solide et sérieux. Jean Jaurès dénonce la « puissance de l’argent », mais il attend la solution d’une réforme globale de la société, sans proposer de solution institutionnelle propre au secteur.
De façon étrange, Dominique Pinsolle n’évoque pas directement la création d’une presse anticapitaliste à ambition nationale, et notamment la création de l’Humanité en avril 1904. Il évoque en revanche le plan de Léon Blum de 1928, pour le coup réellement anticapitaliste en ce qu’il remet en cause la propriété privée de ce moyen de production si particulier qu’est un journal. Léon Blum préconise alors de nationaliser la presse pour la soustraire à l’influence des intérêts économiques et lui redonner la dignité qu’elle aurait dû préserver. Les moyens de production seraient confiés aux partis politiques, de façon à représenter les différentes forces politiques du pays, indépendamment de leur surface financière. Le service public fournirait les moyens de production et de distribution en toute transparence, et une agence d’information internationale serait créée sous l’égide de la Société des Nations. Naïveté d’époque, dirons-nous aujourd’hui, mais signe que la question de la presse, de sa qualité et de son indépendance, devient alors critique pour les partis de gauche et une organisation comme la Ligue des Droits de l’Homme. Leurs réflexions aboutiront aux Ordonnances de 1944.
Après la nationalisation des journaux ayant collaboré au profit de la presse de la Résistance (mesure anticapitaliste par excellence), ces Ordonnances imposent enfin un cadre institutionnel digne de ce nom, avec la transparence de l’actionnariat et des limites à la concentration, avec une réforme de la distribution de la presse et la mise au point de système d’aides publiques… Mais il n’est pas alors imposé de statut particulier aux entreprises de presse afin de les soustraire aux exigences des propriétaires et reconnaître les droits des rédactions, regrette Dominique Pinsolle. Après 1945, peu à peu, la presse de la Résistance disparait, faute de lecteurs et de ressources publicitaires suffisantes ; le capitalisme de presse reprend de sa vigueur, et l’on aboutit à une situation marquée jusqu’aux années 90 par la domination du groupe Hersant puis aujourd’hui, pour le meilleur et pour le pire, par celle de grands intérêts économiques (Dassault, LVMH, Bolloré, et le nouvellement arrivé CMA CGM, faut-il ajouter…). Situation à bien des égards inquiétante2.
De vraies améliorations ?

L’ouvrage est marqué par un certain pessimisme. L’évolution récente fait néanmoins apparaître de vraies améliorations, moins par la création de statuts sociaux ne relevant pas de la logique ordinaire du capital, telle l’entreprise solidaire de presse d’information3, que par les sociétés de rédacteurs qui font entrer les journalistes au capital des organes de presse, pacte d’actionnaires à la clef, comme au Monde, ou par les chartes déontologiques qui viennent renforcer les pouvoirs de journalistes au-delà d’une condition définie par le contrat de travail et le lien de subordination. Certes, Dominique Pinsolle les évoque, ces évolutions, mais il souligne surtout les renoncements de la Gauche à toute réforme institutionnelle sérieuse (de son point de vue) : elle n’aurait pas eu le courage de bloquer l’évolution des radios privées vers le modèle commercial qu’on leur connait aujourd’hui, au mépris de l’esprit d’origine des « radios libres » ; elle augmente les aides aux journaux mal alimentés en recettes publicitaires, mais renonce à une grande loi anti-concentration ; elle ne renforce pas le secteur public de l’audiovisuel…
Le « capitalisme médiatique » l’a emporté, note-t-il, et non sans conséquences politiques car désormais, tout « concourt à marginaliser l’expression des groupes et organisations persistant à lutter à contre-courant du joyeux néo-libéralisme qui envahit à peu près tous les grands moyens de communication » – ce qui n’est pas faux, peut-on ajouter, mais encore faudrait-il qu’il y ait un public pour ce genre de positions politiques.
Il lui reste à souligner que la critique anticapitaliste renaît dans les années 1990 en dehors de la Gauche de gouvernement, dans les travaux de Pierre Bourdieu et de Patrick Champagne ou dans le registre de la dénonciation, comme l’illustrent l’activité de l‘association Acrimed et la publication de certains pamphlets sur les chiens de garde du capitalisme. Dominique Pinsolle croit heureux de rappeler l’existence des journaux éphémères auxquels il a participé, PLPL et Plan B, ou celle de Fakir, le journal de François Ruffin, tous résolument « anticapitalistes ». Mais il en donne aussi les tirages, et c’est admettre que cette critique n’avait, et n’a aucun écho dans l’opinion. Cette presse ne peut sortir de la logique militante, du bénévolat et de l’épuisement rapide des ressources… Pour elle, l’équation sera toujours insoluble.
Ce que cet anticapitalisme ne voit pas
Etrangement, l’auteur ne réfléchit pas vraiment au choc qu’ont pu être, pour les plus grands organes de presse, la numérisation, l’internet et la captation des recettes publicitaires par Google et ses semblables. Probablement est-ce parce que ces évolutions n’entrent pas dans son cadre mental. Le capitalisme des trusts serait-il plus fragile qu’il ne peut le penser dans son schéma foncièrement marxiste ? Ou alors est-ce parce que la baisse des coûts fixes qui vient de la numérisation, de fait, n’a pas donné lieu à constitution de pôles de presse alternatifs hostiles à l’économie de marché ?
Etrangement aussi, s’il la cite en conclusion, Dominique Pinsolle ne discute pas les travaux de Julia Cagé, et notamment son dernier ouvrage écrit avec l’avocat Benoît Huet, L’Information est un bien public4 – livre qui comporte des suggestions intéressantes, et pour une foi, conscientes des contraintes économiques du secteur5, notamment quand ses auteurs préconisent de favoriser l’entrée de fondations dans le secteur des médias. Ces travaux viennent de la gauche radicale, et il faut peut-être suspecter une certaine rivalité de chapelle !
Dominique Pinsolle n’imagine par ailleurs pas que le « capitalisme médiatique » pourrait évoluer si des institutions capitalistes (en un sens), mais relevant de la tierce économie6, soucieuses de préserver une presse de qualité et indépendante de l’establishment économique, décidaient de jouer un rôle actif au nom de leur responsabilité sociale d’entreprise.
Lui en tient toujours pour une forme de nationalisation, modernisant le plan imaginé par Léon Blum en 1928 selon ce qu’un proche du Monde Diplomatique proposait en 2014. L’Etat mettrait à la disposition des journaux d’intérêt général un « service commun » à gestion paritaire, mutualisant l’infrastructure de fabrication, d’administration et de distribution, avec financement par une nouvelle cotisation sociale…
Il est trop facile de rire de ce genre de plan, mais l’idée mériterait d’être creusée, pourvu qu’on le débarrasse de sa gangue « anticapitaliste » et qu’il ne soit pas le prétexte à un système de subventions perpétuelles. La résilience d’un système vient de la diversité des modèles en concurrence. Sans croire au Grand Soir des médias comme Dominique Pinsolle, on peut avec lui imaginer que des pôles de presse aux propriétaires et aux structures diversifiés, ce qui peut aller jusqu’à ce « service commun », permettaient de protéger la qualité de l’information et celle du débat public.
Stéphan Alamowitch
Maitre de conférences à l’IEP de Paris (Séminaire “Economie et régulations des médias”)
À BAS LA PRESSE BOURGEOISE ! Deux siècles de critique anticapitaliste des médias. De 1836 à nos jours, Dominique Pinsolle, Editions Agone (2022)
Lire aussi : Sauver les médias, disent-ils (31 mai 2021), sur l’ouvrage L’Information est un bien public. Refonder la propriété des médias
Notes
| ↑1 | Sans parler de la presse collaborationniste ! |
|---|---|
| ↑2 | Dominique Pinsolle regrette que la lutte contre les censures (celle de l’Etat, celle des islamistes) rejette la question de l’influence des intérêts financiers aux marges du débats sur la presse, ce qui n’est ni vrai ni faux. |
| ↑3 | L’entreprise solidaire de presse d’information (ESPI) est un statut spécial crée par la loi du 17 avril 2015, qui réduit la possibilité de distribuer des profits aux associés. |
| ↑4 | L’Information est un bien public. Refonder la propriété des médias de Julia Cagé et Benoît Huet. Le Seuil 2021. |
| ↑5 | Ce qui n’était pas le cas dans le précédent livre de Julia Cagé Sauver les médias, Capitalisme, financement participatif et démocratie (2015). Voir notre article de 2015 ici. |
| ↑6 | Mutuelles, caisses de retraite, associations et fondations diverses… |