Réflexions sur l’essai de Renaud Dély Anatomie d’une trahison, la gauche contre le progrès1
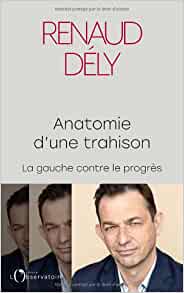
L’évolution politique et intellectuelle (mais à gauche les deux sont souvent liées) d’une partie non négligeable de la gauche ne cesse de poser question. En effet, on n’est plus en présence d’idées qui peuvent être contestables mais qui sont assises sur un corpus doctrinal solide (comme l’était le marxisme) mais le plus souvent d’élucubrations pseudo-savantes, avec parfois des emprunts à des courants racialistes qui étaient, jusque-là, l’apanage de l’extrême droite. Renaud Dély nous décrit tous les symptômes de cette dérive, et il le fait en homme de gauche mais en homme de gauche qui n’a pas renoncé à l’idée de progrès. Car c’est là la thèse de l’auteur : la gauche a renoncé à son héritage des lumières, elle a tourné le dos au progrès et à l’universalisme. L’idée que demain sera meilleur qu’aujourd’hui sous l’action conjuguée des hommes fait désormais débat, et les a priori apocalyptiques d’une large partie du courant écologique démonisent l’idée même de progrès. Tournant le dos au progrès, cette gauche adopte par la même occasion des conceptions identitaires qui sont inquiétantes : l’idée que l’homme était son propre Prométhée, selon l’expression de Michelet, est éclipsée par un déterminisme qui plonge ses racines dans les théories sinon racialistes du moins très conservatrices du XIXème siècle. La race, le milieu, le moment d’Hyppolyte Taine ne sont jamais loin !
Pour l’auteur, c’est de fait tout l’héritage républicain que cette nouvelle gauche a répudié, et c’est le fait majeur de l’histoire des idées de ces 50 dernières années. Cette nouvelle gauche ne s’inscrit donc plus dans la continuité idéologique de l’ancienne. La rupture est profonde et de nature épistémologique. Dans l’état actuel des choses, la rupture est sans retour et le back to basics souhaité par l’auteur dans son chapitre terminal ne l’illusionne guère. Le mal est profond et la simple évocation des mots nation, raison, progrès, universalisme et laïcité met cette nouvelle gauche dans tous ses émois. Pour Renaud Dély, le communautarisme auquel se raccroche de plus en plus ce nouveau courant politique est aussi la conséquence d’un autre abandon : celui de la laïcité. C’est tout l’édifice politique et institutionnel qui s’était construit au moment de l’affaire Dreyfus qui est remis en cause et où l’on voit un Jean-Luc Mélenchon faire l’impasse systématique sur cette question alors même qu’elle était encore centrale dans son discours il y a quelques années. C’est là encore une rupture sans précédent avec l’ancienne gauche : la communauté a éclipsé l’individu. Les individus sont en permanence renvoyés à leurs origines, notamment à leurs origines ethniques. Un déterminisme culturel pèse sur eux, qu’il faut désormais accompagner et non plus combattre. L’islamisme n’est plus vu comme un symptôme inquiétant mais comme une manifestation culturelle respectable d’une communauté particulière !
Un entre-soi urbain et très souvent bourgeois
Bien entendu et Dély le souligne, ces thèses cultivées dans un entre-soi urbain et très souvent bourgeois éloignent les classes populaires de cette nouvelle gauche qui se réfugient alors dans le vote populiste version droitière. Plus grave, les classes moyennes font aussi défaut, et on n’oubliera pas que le succès de Macron aux élections de 2017 venait pour une part non négligeable du fait que le candidat choisi par le parti socialiste, Benoit Hamon, était déjà un parfait représentant de cette nouvelle gauche. Ses propositions qui soient prêtaient à sourire, soient étaient irréalisables, avaient pourtant été plébiscitées par la base militante du PS. C’est un fait politique qui, à l’époque, a peu retenu l’attention et qui pose une question centrale : comment cette base militante a-t-elle pu faire sécession à ce point avec les préoccupations du peuple français ? L’explication sociologique est souvent privilégiée et à raison. Ces militants très largement issus de cette bourgeoisie urbaine et intellectuelle vivent dans un microcosme particulier aux antipodes des réalités vécues par l’immense majorité des Français. C’est indiscutablement vrai, mais cela n’explique pas leur forte propension à adhérer à des idées dénuées de toute rationalité et pour certaines très inquiétantes. Comment des personnes supposées intelligentes peuvent-elles défendre des idées aussi farfelues et très souvent extrémistes ? Comment au XXIème siècle peut-on encore légitimer la violence physique vis-à-vis des adversaires politiques ? Certes, l’adhésion à des idées douteuses de la part de publics cultivés n’est pas un phénomène nouveau. Mais l’ampleur du phénomène et sa durée dans le temps interrogent. Comment la raison qui était au fondement même de la philosophie des lumières a-t-elle pu à ce point s’éclipser ?
On objectera aussi que la critique du progrès à gauche n’est pas nouvelle, et que Georges Sorel en son temps lui avait consacré un ouvrage2. Mais quoi que l’on puisse pense de Sorel, son ouvrage était argumenté et l’objectif était clair : révéler que l’idéologie des Lumières était d’abord et avant tout une idéologie bourgeoise, idéologie qui s’était construite contre les intérêts du peuple. Faire du socialisme dans son ensemble un fils des Lumières est aller un peu vite en besogne et le propos mériterait d’être nuancé. Tout n’est pas si linéaire et la référence à la Révolution française chez les socialistes français du XIXème siècle était très sélective. Pareillement, on pourrait montrer à la suite des travaux de Marc Crapez3 que l’idéologie révolutionnaire a souvent fait bon ménage avec les théories racialistes. Que ces courants soient peu étudiés ne signifie nullement qu’ils n’ont pas existé ou étaient marginaux!
De surcroit, cette nouvelle gauche se réclame aussi du progressisme. L’individu y est souvent sacralisé. Toute la logique du nouveau progressisme vise à « l’empoweriser » en lui permettant d’exploiter toutes ses potentialités. Ce nouveau progressisme paraît pousser la logique individuelle jusqu’à son paroxysme. Ce point mériterait débat mais Dély ne s’y arrête pas.
S’il souligne avec justesse le peu de sérieux intellectuel de ces différents courants, il n’en entrevoit pas toujours la conséquence : la violence. Lui qui aime évoquer les années 30 lorsqu’il s’agit de décrire la droite populiste contemporaine ne s’arrête pas sur ce symptôme si caractéristique de ces fameuses années 30. Que cela concerne l’alimentation ou le combat des idées, cette nouvelle gauche ne cherche plus à convaincre, mais à imposer sa nouvelle vision du monde par la force, en n’hésitant pas quand il le faut à perturber des colloques ou à judiciariser toute expression jugée non conforme. Là aussi, il serait facile de lier éclipse de la rationalité et violence. Quand on ne démontre plus, on excommunie et quand on dénie à son contradicteur toute légitimité à débattre, la violence n’est jamais loin. L’invective est devenue un de ses identifiants, invective qui n’épargne pas les représentants de l’ancienne gauche, notamment ceux qui osent parler de gastronomie comme Fabien Roussel !
Cet épisode sur lequel revient Dély est intéressant à plus d’un titre. En premier lieu, il révèle le déphasage total de cette nouvelle gauche avec les habitudes alimentaires communes. Mais ce qui est plus grave, c’est le procès en illégitimité fait à ces habitudes alimentaires et le fait qu’elles révéleraient un côté franchouillard insupportable. Pour Sandrine Rousseau, si on aime la bonne viande servi avec un bon vin, c’est qu’on est contre le couscous ! Ce qui aurait fait hurler de rire il y a encore quelques années provoque un débat surréaliste aujourd’hui. Mais la question à laquelle à vrai dire ne répond pas Dély est celle-ci : comment en est-on arrivé là ?

C’est peut-être là la faiblesse de cet ouvrage. Pour Dély, les choses sont simples : la cause première de cette dégénérescence intellectuelle de cette nouvelle gauche réside dans le fait qu’elle a rompu les digues avec son histoire, qu’elle ne se reconnait plus dans ses marqueurs intellectuels qui lui étaient consubstantiels. Le problème est que, ce faisant, Dély tend à confondre cause et conséquence. L’énigme qu’il reste à expliquer consiste à révéler les origines intellectuelles de cette gauche, comment s’est-elle structurée et sur quels enjeux ?
La contre-culture américaine des années 60 et 70 ?
Si on souligne le fait qu’elle est très largement issue de la contre-culture américaine des années 60 et 70, il reste à expliquer comment elle s’est répandue progressivement sur les autres continents et comment elle est devenue l’idéologie officielle des élites progressistes. Ce serait commettre une grave erreur d’appréciation de confiner ce nouveau progressisme à la seule gauche radicale car à la vérité, il irrigue tout le champ politique progressiste, de la social-démocratie à la gauche mélenchoniste. La Nupes ne résulte pas seulement d’un seul rapport de force. Le rapprochement a été aussi rendu possible par l’adhésion des bases militantes qui la composent aux mêmes référents idéologiques.
Si Renaud Dély souligne à juste titre l’origine très américaine de beaucoup de ces théories, il ne dit pas grand-chose de leur milieu d’éclosion, des mouvements qui les ont portées et de la façon dont elles se sont imposées dans les lieux où se produisent et se diffusent les idées, et notamment dans les universités. Ce n’est pas tant la force intrinsèque des idées qui leur assure une hégémonie à un moment ou à un autre, mais la capacité de ceux qui les portent à les imposer. Pour prendre l’exemple de l’Université, la montée en puissance du gauchisme culturel, selon l’expression de Jean-Pierre Le Goff, est redevable de la rencontre de deux phénomènes : d’une part, la production de théories séduisantes. Pour le sociologue Raymond Boudon une théorie séduisante vise à simplifier le réel en répondant à un moment donné aux interrogations de groupes plus ou moins importants. Les théories séduisantes ne visent pas à comprendre, mais à donner une explication acceptable et partagée à des phénomènes complexes. Elles visent donc plus à convaincre qu’à expliquer, et c’est là leur vice caché épistémologique.
Mais cela ne suffit pas car les idées ne peuvent perdurer que si les positions de pouvoir de ces groupes restent stables ou se renforcent. Dans le cas précis de l’Université c’est la conquête systématique des lieux de pouvoir (commissions de recrutement, instances décisionnelles etc…) qui ont permis à des groupes militants assez bien identifiés d’imposer leur agenda idéologique. Leur passé militant leur a, en effet, procuré des ressources importantes qui les a rendus plus aptes que d’autres à repérer et conquérir ces lieux de pouvoir4.
De surcroît, lorsque l’on souligne le caractère farfelu, douteux voire dangereux de ces théories on part toujours de l’idée que celles-ci seraient émises et diffusées dans le but d’influencer les agendas politiques et qu’elles seraient ainsi à l’origine des nouvelles façons de faire et de penser la politique.
Or, il faut le souligner, ces nouvelles théories sont nées dans un contexte politique précis : le décrochage des partis progressistes de leur électorat originel, constitué très majoritairement des catégories populaires. Ainsi, la montée en puissance du référent communautaire dans le débat intellectuel et politique américain est inexplicable si on ne comprend pas que les élites progressistes américaines devaient rendre acceptable leur sécession en légitimant de nouveaux électorats sans lesquels elles eussent été marginalisée. Christopher Lasch révèle justement comment ces élites se sont mises soudainement à démoniser l’Amérique périphérique, l’accusant de tous les maux dont celui de racisme ! On pourrait faire les mêmes remarques avec la montée en puissance en France dans les années 80 d’un mouvement anti-raciste dont l’inspiration nord-américaine était évidente. Certains universitaires et intellectuels aiment à penser qu’ils sont à l’origine des mouvements d’idées, alors qu’ils sont surtout de simples sous-traitants ou les relais intéressés de recompositions politiques pensées élaborées et mises en œuvre ailleurs ! La fameuse note Terra Nova qui a tant fait parler d’elle en 2011 en est le plus parfait exemple. En 2011, la stratégie telle que décrite par le Think Tank progressiste était déjà à l’œuvre depuis longtemps mais cette stratégie n’était pas assumée par le Parti socialiste. Terra Nova ne produisait en aucun cas un document prospectif, son objectif était essentiellement de rendre légitimes des pratiques déjà effectives. Curieux que l’on se soit mépris à ce point sur cette fameuse note !
Les nouvelles forces militantes qui ont investi l’Université à partir de la fin des années 70, éclipsant peu à peu le marxisme ou le structuro-fonctionnalisme, ont très souvent lié leur destin professionnel à la montée en puissance idéologique de ces nouveaux courants dans les structures partisanes. Ces universitaires ont ainsi autant besoin du pouvoir politique que le pouvoir politique a besoin d’eux. Sans intervention du politique, ils n’auraient pu acquérir de telles positions de pouvoir dans le champ intellectuel. Ces liens de dépendance de nature quasi incestueuse posent problème car ils remettent en cause le fondement même du travail universitaire : l’indépendance !
Les grandes entreprises
Un autre point que ne souligne pas Renaud Dély est que cette idéologie s’est aussi diffusée dans les entreprises et les plus grandes d’entre-elles. Thomas Frank, dans un ouvrage passé quelque peu inaperçu 5 et qui est représentatif de cette gauche démocrate qui se veut fidèle à l’héritage rooseveltien, en analyse bien, selon nous, les mécanismes. À partir de la fin des années 70, souligne-t-il, les élites américaines culturelles et économique américaines vont fusionner. Issues des mêmes grandes universités, elles vont constituer la nouvelle élite progressiste qui devient dominante aussi bien dans le domaine politique qu’économique. Ce rapprochement a été rendu possible par l’éclosion au début des années 80 de la nouvelle économie qui, on le souligne trop rarement, est née et s’est développée dans l’écosystème californien et qui est aussi très marqué par la contre-culture née sur les campus californiens. Or, aujourd’hui ces entreprises sont devenues les principaux vecteurs de diffusion de ce nouveau progressisme, imposant ses thèmes favoris dont l’idéologie diversitaire6 qui n’est jamais très éloignée d’a priori identitaires rarement explicités. Il n’est pas neutre de constater que le parti républicain qui était, jusque dans les années 80, le parti du big business ne cesse de fustiger ces entreprises coupables d’endoctriner les américains et d’encourager un racisme sournois. Cette idéologie est d’autant plus diffusée qu’au fond, elle ne remet pas en cause le système mais donne l’illusion qu’on règle les problèmes alors mêmes que l’on ne s’attaque pas à leurs causes.
Les slogans là aussi ont remplacé l’analyse. Cet investissement sociétaliste des entreprises de la nouvelle économie (mais pas uniquement) correspond parfaitement à l’agenda politique des démocrates américains. On ne sera pas étonné à partir de là de constater que le management (dans ses versants académique et opérationnel) soit devenu un producteur non négligeable de cette idéologie et qu’il devient très difficile de la discuter. L’idéologie culturaliste qui irrigue le management contemporain ne repose sur aucun fondement scientifique sérieux, ce sont des assertions qu’il est très facile de démonter mais qui le sont rarement pour les raisons exposées plus haut Quand les agendas intellectuels, politiques et économique deviennent un seul et même agenda, ce n’est pas seulement la liberté académique qui est remise en cause, c’est la liberté dans son ensemble.
Jean-Claude Pacitto
Notes
| ↑1 | Renaud Dély, Anatomie d’une trahison, la gauche contre le progrès, 2022, édition de l’Observatoire, 185 pages. |
|---|---|
| ↑2 | Georges Sorel, Les illusions du progrès, L’Age d’Homme, 2007, 251p. |
| ↑3 | Marc Crapez, La gauche réactionnaire, Mythes de la plèbe et de la race, Berg, 1997, 339 p. |
| ↑4 | Ayant été un observateur direct et privilégié de la montée en puissance de ce courant idéologique, je suis bien placé pour savoir que cette conquête de l’hégémonie intellectuelle ne doit rien à une production plus efficiente d’idées, mais beaucoup à une conquête systématique des lieux de pouvoir, que cela concerne les revues ou les instances organisationnelles diverses. |
| ↑5 | Thomas Frank, Pourquoi les riches votent à gauche, Agone 2018, 425 p. |
| ↑6 | Sur cette question, de nombreux exemples dans le livre d’Anne de Guigné Le capitalisme woke, Presses de la cité, 200p. |