
Igor Stravinsky est mort le 6 avril 1971. Ce demi-siècle écoulé est une bonne occasion de refaire le point sur l’homme et l’œuvre, et le livre de Lionel Esparza est le bienvenu. Comme nous le rappelle l’auteur en introduction, la nouvelle de la disparition de Stravinsky a été reçue comme un événement d’importance internationale. Pour en trouver un équivalent, il faudrait remonter à celle de Wagner, à coup sûr, ou de Beethoven probablement. En effet, nous rappelle l’auteur, Stravinsky était considéré comme « le plus grand compositeur du XXe siècle peut-être ». Ce « peut-être » restrictif tombe d’ailleurs quand la formule est reprise à l’avant-dernier chapitre, comme si, à ce stade, le doute n’était plus permis.
Autre qualificatif appliqué à Stravinsky en introduction, « emblématique » lui convient on ne peut mieux. D’abord en raison de son parcours biographique, de la Russie des tsars à l’exil, qui le place en compagnie d’autres grands contemporains comme Balanchine et Nabokov. Mais aussi au sens où Stravinsky incarne et synthétise les grands débats esthétiques de son siècle : symbole même de la modernité musicale avec Le Sacre du printemps en 1913, puis lui tournant le dos en faveur du néoclassicisme auquel son nom demeure tout aussi fortement attaché ; et enfin, lorsqu’il abandonne cette esthétique antimoderne (ou prétendue telle) au milieu des années cinquante, pour donner sa version à lui de la modernité musicale la plus radicale, que le discours dominant présentait alors comme l’horizon indépassable de notre temps. Cette évolution imprévisible, caméléonesque de Stravinsky, avec ses reniements et ses ralliements, n’est pas l’une des moindres questions auquel le livre de Lionel Esparza se propose de répondre.
Si la carrière de Stravinsky est longue – en gros, de Feux d’artifice (1909) aux Requiem Canticles (1966) –, on ne peut dire qu’elle ait été particulièrement précoce. Il est né le 17 juin 1882 selon le calendrier grégorien (le 5 juin selon le calendrier julien alors toujours en vigueur dans l’empire russe) à Oranienbaum, petite ville en bordure de la Baltique célèbre avant tout comme siège de l’une des splendides résidences impériales voisines de Saint-Pétersbourg. Son père, Fyodor Ignatyevich Stravinsky (1843-1902), fameuse basse d’opéra d’origine polonaise, avait créé le rôle de Varlaam dans Boris Godounov de Moussorgski. Comme le souligne Lionel Esparza, Stravinsky, même si l’on fait la part de sa santé fragile, ne paraît pas avoir eu une enfance heureuse. En dépit de bonnes études musicales, qui font de lui un excellent pianiste, sa vocation n’est pas soutenue par son père, qui le destine au droit. Par bonheur, à la faculté, il se lie d’amitié avec Vladimir Rimsky-Korsakov, le plus jeune fils du compositeur. Celui-ci prend Igor sous son aile à partir de 1901 et c’est avec cet habile pédagogue (qui n’a pas donné son nom pour rien au Conservatoire de Saint-Pétersbourg) disposant de multiples contacts, que Stravinsky doit sa formation de compositeur. Comme le note pertinemment l’auteur, paraphrasant une formule de Berlioz, ce dernier a « pris la musique exactement là où son professeur l’a laissée ». En effet, les ressemblances sont frappantes entre les premières œuvres de Stravinsky et celles de son maître : l’opéra féeriquede Rimsky Kachtcheï l’immortel (1902) pourrait, indépendamment des points communs des livrets, être signé de l’auteur de L’Oiseau de feu (1910).

Léaon Bakst, costume pour l’Oiseau de feu
La carrière de Stravinsky, qui en 1905 a épousé sa cousine germaine Katya Nosenko, démarre en 1910. En janvier, Feux d’artifice est joué à Saint-Pétersbourg aux concerts Ziloti ; et L’Oiseau de feu est créé à Paris le 25 juin par les Ballets russes. Pour ces derniers, Stravinsky avait précédemment orchestré deux des pièces de Chopin qui forment la matière des Sylphides (1909). La commande de L’Oiseau de feu était en fait un accident chanceux dû au désistement successif de Liadov et de Tcherepnine, d’abord pressentis pour en écrire la musique. La suite est connue, et elle est racontée avec brio par Lionel Esparza. Le triomphe de L’Oiseau de feu fait de Stravinsky une célébrité du jour au lendemain. Celui de Petrouchka (1911) n’est pas moindre.
Et puis vient le « scandale » du Sacre du printemps lors de sa création au Théâtre des Champs-Élysées le 29 mai 1913. Dans les pages qu’il y consacre, l’auteur parle de « malentendu », au sens littéral. Une préparation imparfaite, une chorégraphique problématique – même si le travail de Nijinski a trouvé depuis des partisans –, ont empêché le public de prendre la mesure de cette partition novatrice. Le malentendu se dissipe d’ailleurs dès l’année suivante lorsque l’œuvre est exécutée en concert. (On note au passage avec intérêt que Stravinsky était grand admirateur de l’Elektra de Strauss, œuvre avec laquelle l’orchestre du Sacre n’est pas sans rapports.) Dernière création de l’avant-guerre, l’opéra Le Rossignol, d’après H.-C. Andersen, est évoqué ici comme une œuvre hybride et plutôt décevante. Elle a pourtant eu, à l’époque, des défenseurs, tels Reynaldo Hahn, pour qui le spectacle était le plus harmonieux et le plus beau de ceux présentés jusqu’alors par les Ballets russes.
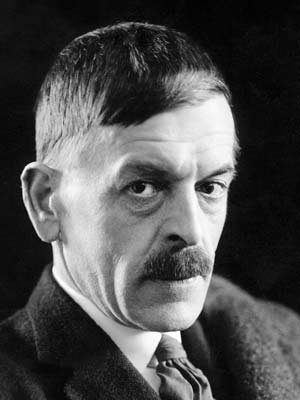
Après viennent les années de guerre, marquées, sur le plan musical, par la fructueuse rencontre avec le romancier suisse Charles-Ferdinand Ramuz, à laquelle on doit ces chefs-d’œuvre du théâtre musical avant la lettre que sont Renard et L’Histoire du soldat ; et, sur le plan personnel, les conséquences, financièrement désastreuses, du putsch bolchevique d’octobre 1917. Ce sont également les années de la composition de Noces, probablement la plus méconnue parmi les mélomanes actuels des grandes œuvres de Stravinsky. Cette méconnaissance est peut-être liée à la création tardive (1923) des Noces, Stravinsky n’ayant achevé l’orchestration que peu avant la première. Or son œuvre avait changé de direction de façon spectaculaire avec la création de Pulcinella (1920), où étaient « recyclées », dans un langage musical résolument moderne, des pièces de Pergolèse ou attribuées à ce dernier. Ce tournant néoclassique, si l’on prend la notion au sens large, était en fait dans l’esprit du temps. En peinture, il a affecté des artistes aussi différents que Picasso (par ailleurs auteur des décors de Pulcinella), Chirico et Severini. En musique, comme Lionel Esparza le remarque avec justesse, il n’était d’ailleurs pas neuf en soi, comme le montrent les exemples de Massenet (Manon, Chérubin) et de Delibes (Le roi s’amuse, Le roi l’a dit), auxquels on pourrait ajouter le Strauss de la première version d’Ariane à Naxos (1912). Cela n’empêche pas la musicologie anglo-américaine de restreindre strictement, aujourd’hui encore, la définition du mot néoclassicisme à ce pan de l’œuvre de Stravinsky N’est-ce pas une indication de la place qu’il a acquise dans l’histoire de la musique ?
Quoi qu’il en soit, les années vingt sont jalonnées de chefs-d’œuvre : les Symphonies d’instruments à vent (1921) ; l’Octuor (1923), également pour vents ; le Concerto (1924) pour piano et instruments à vent ; l’opéra-oratorio Oedipus Rex, sur un texte de Cocteau (autre néoclassique des années vingt) traduit en latin par le futur cardinal Daniélou ; le ballet Apollon Musagète (1928), qui marque la rencontre avec Balanchine (après une création à Washington dans une chorégraphie différente, due à Adolph Bolm) ; et le Capriccio pour piano et orchestre. Certes, Œdipus Rex est un demi-échec à la création, de même que le ballet Le Baiser de la fée (1928), tandis que l’opéra-bouffe en un acte Mavra (1922), d’après Pouchkine, est un franc échec. Inspirée par la mort soudaine de Diaghilev en 1929, la Symphonie de psaumes, un des sommets de toute son œuvre, conclut cette décennie prodigieuse.

Sur le plan personnel, la vie de Stravinsky connaît elle aussi un tournant en 1922 lorsque commence sa liaison – en fait sorte d’arrangement bigame à peine clandestin – avec la danseuse Vera de Bosset. Bosse de son vrai nom, née en Russie mais sans une goutte de sang russe, elle était au moment de leur rencontre l’épouse du peintre et décorateur Serge Sudeikin (auquel on doit le portait ci-contre). Parallèlement à cette entorse à la morale conventionnelle, Stravinsky, comme bien d’autres dans les années vingt, passe alors par une sorte de crise religieuse. Il réintègre la religion orthodoxe, lit et fréquente le philosophe néothomiste Jacques Maritain, en partie sous l’influence de son porte-parole du moment, Arthur Lourié (1891-1966), compositeur russe émigré avec lequel il finira par se brouiller définitivement comme avec tant d’autres.
Par rapport aux années vingt, les années trente – celles de la Crise – voient la fécondité de Stravinsky marquer le pas. Certes, il publie son autographie sous le titre de Chroniques de ma vie (1935-1936), mais il faut préciser qu’elle a été ghostwritten par Walter Nouvel, l’un des proches collaborateurs de Diaghilev dès l’époque de la revue Mir Iskusstva. Même Perséphone, mélodrame sur des paroles de Gide, commande d’Ida Rubinstein, est un demi-échec à l’Opéra en 1934. Après un premier voyage en 1924-1925, Stravinsky se tourne de plus en plus vers les États-Unis, source de commandes alors que celles-ci se réduisent en Europe. Le violoniste Samuel Dushkin, avec qui il se produit en duo, lui commande le Concerto pour violon (1931), de riches mécènes de Washington, D. C. (et non de l’État de Washington comme un lapsus de l’auteur semble l’indiquer) le Concerto Dumbarton Oaks. En 1937 il dirige à New York la création du ballet Jeu de cartes, dans une chorégraphie de Balanchine, et en 1940, à Chicago, la Symphonie en ut, le grand chef-d’œuvre de la période. L’année précédente, Stravinsky a profité d’une invitation de Harvard, où il donne les six conférences publiées ensuite sous le titre de Poétique musicale – rédigées en fait par Roland-Manuel avec des interventions de Pierre Souvtchinski – pour s’installer en Amérique. Il entame donc un troisième exil, rejoint en janvier 1940 par Vera, que la mort récente de Katya lui permet enfin d’épouser, et le couple se fixe à Hollywood. Tous deux obtiendront la nationalité américaine en 1945.
À part les Danses concertantes (1942) pour orchestre de chambre, les années de guerre donnent lieu principalement à des œuvres de circonstance. Commande de la Philharmonie de New York, la Symphonie en trois mouvements (1946), qui renoue avec la grande inspiration des années vingt, est d’ailleurs partiellement recyclée d’une musique de film. À l’exemple de Dvorak, Stravinsky n’est pas indifférent à la musique de son pays d’adoption, comme en témoignent ses deux compositions pour jazz band : le Scherzo à la russe (1944) commandé par Paul Whiteman et l’Ebony Concerto (1946) écrit pour Woody Herman. C’est l’époque où Stravinsky entreprend en outre la révision de ses partitions antérieures, ce qui lui permet de s’assurer du copyright américain. Comme Lionel Esparza en donne maint exemple, l’argent, dont Stravinsky s’est toujours soucié, devient à cette époque une obsession qui ne fera que croître.

L’année 1947 voit la création d’Orphée, commande de la Ballet Society, futur New York City Ballet ; cette œuvre, qui lui tenait à cœur, reste néanmoins relativement méconnue. C’est aussi l’année où Stravinsky entreprend son dernier projet lyrique, The Rake’s Progress, qui, plus encore que Le Rossignol, est un véritable opéra. C’est même un opéra traditionnel avec airs et ensembles, dans la tradition de Mozart, avec récitatifs accompagnés au clavecin. Le sujet, inspiré par une fameuse série de peintures de William Hogarth, est une trouvaille du compositeur. Quant au livret, d’une haute qualité littéraire, il a été écrit par le poète anglais W.H. Auden – recommandé à Stravinsky par Aldous Huxley, son voisin de Hollywood – en collaboration avec son amant et collaborateur attitré Chester Kallman. La création à la Fenice suscite un grand retentissement, mais Lionel Esparza n’a pas tort de souligner que l’œuvre a mis du temps à s’imposer au répertoire : elle n’en est pas moins l’un des rares opéras de la seconde moitié du vingtième siècle à y figurer.
Avec le Rake prend glorieusement fin la période néoclassique de Stravinsky. Le changement qui s’opère alors chez le compositeur est une énigme que Lionel Esparza s’attache patiemment à élucider. Cette transformation est clairement liée – mais dans quelle mesure exacte est moins clair – à l’arrivée dans la vie de Stravinsky, en 1948, d’un jeune musicien américain nommé Robert Craft, et qui n’allait pas tarder à devenir comme un membre de la famille. (L’auteur le désigne par son prénom, mais en ce cas pourquoi ne pas l’appeler Bob comme tous ceux qui l’ont connu ?) On a beaucoup discuté, en bien ou en mal, de la nature de l’influence de Craft, mais elle a été évidemment considérable : secrétaire assistant, interprète, intermédiaire indispensable, exégète, collaborateur, porte-plume, gardien du temple, il a été tout cela, avec autant de talent que d’entregent. Une chose est sûre, et Lionel Esparza a raison d’insister sur ce point : quelle qu’ait été l’influence de Craft, la conversion spectaculaire de Stravinsky au dodécaphonisme n’aurait pas eu lieu si elle n’avait correspondu chez lui à une aspiration profonde. L’auteur l’explique de manière convaincante, en la rattachant au culte de Stravinsky pour l’ordre et la discipline, en art comme en politique. Il est donc parfaitement cohérent qu’elle se soit exprimée principalement dans la musique religieuse (catholique de surcroît), peu prisée des modernistes bon teint.
Cette évolution ne pouvait évidemment pas se produire du vivant de Schoenberg, disparu en 1951, année où, comme par hasard, Craft s’installe définitivement chez les Stravinsky. Elle ne se manifeste que progressivement. Lorsque Stravinsky est honoré à Paris en mai 1952, pour ses 70 ans, dans le cadre du somptueux festival organisé par Nicolas Nabokov à Paris sous le titre L’Œuvre du vingtième siècle, c’est encore le Stravinsky du Sacre et le Stravinsky néoclassique que l’on célèbre. (À propos de ce festival, financé en effet sous le manteau par le canal de la CIA, on ne saurait dire que objectifs politiques – opposer la vitalité de la culture dans les pays libres aux pressions et persécutions que subissent les créateurs vivant sous des régimes totalitaires – étaient tenus secrets, puisqu’ils étaient officiellement proclamés dans le programme1
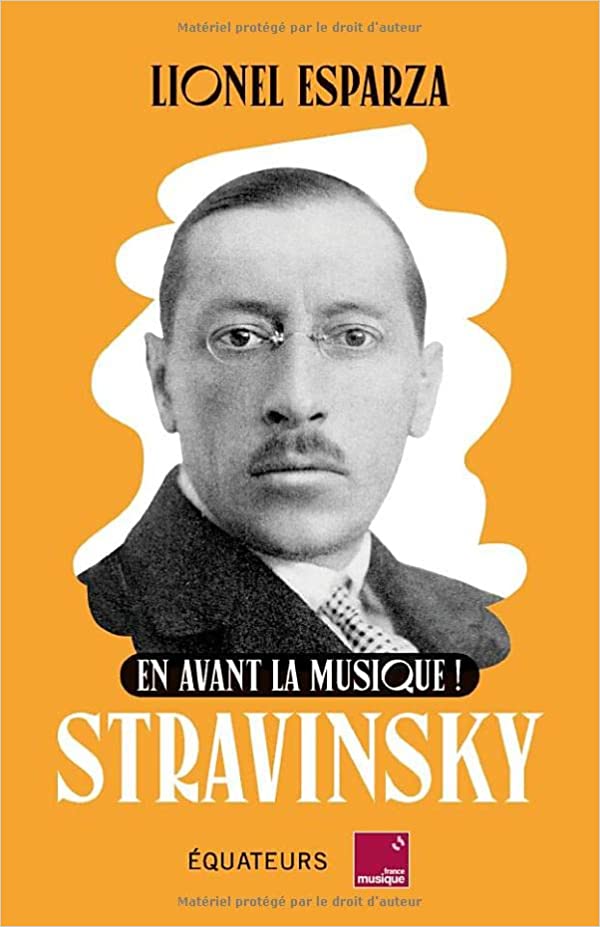
Les chapitres consacrés au Stravinsky dodécaphoniste, du Canticum sacrum (1956) aux Requiem Canticles, sont parmi les meilleures pages du livre, de même que l’évocation de la tournée triomphale de 1962 en Russie soviétique et de l’inéluctable déclin du compositeur après 1965. On ne lira pas avec moins de profit le chapitre conclusif, où l’auteur partage ses réflexions sur la place de Stravinsky dans la musique de son temps. Il soutient de manière convaincante que, plutôt qu’un moderne comme on aurait naturellement tendance à le penser, celui-ci est au fond un postmoderne. En effet, si l’on se réfère à la définition classique de Jean-François Lyotard, la carrière artistique de Stravinsky – semblable en cela, et seulement en cela, à celle de Picasso, parallèle souvent tenté mais qui ne tient pas la route – indique une superbe indifférence vis-à-vis des « grands récits » (y compris le discours dodécaphoniste, qui lui a été longtemps suspect). Et ses réussites fulgurantes – la liste de ses chefs-d’œuvre ne craint pas les comparaisons – sont plutôt autant de « coups » au sens postmoderne, à condition de prendre le mot dans une acception supérieure. Vue sous cet éclairage, la personnalité de Stravinsky, si déconcertante, si décevante parfois, se comprend mieux par rapport à son œuvre, laquelle n’a pas fini de nous émerveiller2.
La lecture de ce livre, aussi agréable que stimulante, est à recommander à toute personne qui s’intéresse, non seulement à Stravinsky, mais à la musique du vingtième siècle.
Vincent Giroud
Lionel Esparza. Stravinsky : En avant la musique ! Paris, Équateurs ; France Musique, 2022, 220 p. ISBN : 978-2-3828-4284-3
Notes
| ↑1 | L’auteur de ces lignes demande la permission de renvoyer à la brochure qu’il vient de publier sur ce festival, en hommage à Sabine Weiss qui en avait été le témoin, dans la série « Chroniques du Théâtre des Champs-Élysées ». |
|---|---|
| ↑2 | Un fact-checker rigoureux, dont ne dispose probablement pas la maison Équateurs, aurait permis de repérer certains noms estropiés, probablement cités de mémoire, comme Nikisch et Henry Prunières, ou le ballet Giselle ici appelé Gisèle. Il ou elle aurait su attirer l’attention de l’auteur sur le fait qu’il ne faut pas dire « Université de Harvard », Harvard étant une personne et non un lieu, et que le pape Jean XXIII, mort en 1963, n’était guère en état d’anoblir Stravinsky trois ans plus tard. |