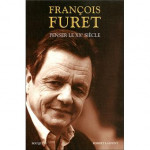
Dans plusieurs articles du Débat1 parus dans les années 1990, François Furet (1927-1997) avait analysé la situation des Etats-Unis, notamment à la suite de l’élection de Jimmy Carter puis de celle de Bill Clinton. Son analyse de ce que l’on n’appelait pas encore les « identity politics » garde une justesse étonnante, même si l’on peut parfois penser que le paradigme tocquevillien qui l’inspire (la passion de l’égalité) n’épuise pas, à l’orée des années 2020, la question des revendications communautaires, qui dissimulent probablement un bon vieux holisme, prêt à reparaître à la faveur de toutes les crises sociales. La situation actuelle des Etats-Unis le pousserait probablement à juger les évolutions dont il notait les prémices, disons… moins pittoresques, et contrairement à ce qu’il escomptait en 1997, le Parti Républicain n’a pas résisté aux prédicateurs réactionnaires.
Nous avons ici retenu, presque au hasard, deux extraits d’articles parus dans Le Débat en 1992 et 1997. Il en existe d’autres, tout aussi pertinents qu’on trouvera dans les collections de cette revue, et de façon plus pratique dans le remarquable recueil d’articles et de textes de François Furet qui composent Penser le XXème siècle, paru dans la collection Bouquins aux Editions Robert Laffont en 2007. Une autre époque.
Extraits du Débat, n°69, daté mars avril 1992
(…) En effet, c’est là que les choses deviennent plus énigmatiques. Aujourd’hui, aux Etats-Unis, la séquence « Blacks, women, minorities » a une valeur quasi litanique, le terme de minorities comprenant, en plus des Noirs et des femmes, les « Latinos » (Mexicains en tête), les Orientaux (mais pas les Juifs, exclus, pour la première fois de l’histoire universelle sans doute, de ce statut de minorités !), enfin les homosexuels (des deux sexes). L’énumération dit assez combien la liste est hétérogène, le concept confus, et pourtant elle est devenue slogan, et elle implique comme une sorte d’évidence pour les militants de la cause et au-delà.
En elle-même, l’idée des minorités est familière aux Américains puisqu’elle est inséparable de la manière dont s’est constitué le pays, par vagues d’immigrants qui ont conservé chacune dans leur nouvelle patrie quelque chose de leur communauté d’origine. Son emploi actuel élargit à l’infini cette notion de particularités culturelles propres à un groupe donné, et il n’y a pas de mot employé plus à tort et à travers que celui de « cultures » dans le vocabulaire américain d’aujourd’hui. Il présente au moins cet avantage d’exprimer une des obsessions du mouvement PC, à savoir que rien ne se présente à l’homme comme une donnée naturelle, mais que tout est socialement construit, tout est politique. L’homosexualité est une culture, comme la féminité, ou le fait d’être noir, ou portoricain, ou chinois, et toutes les cultures respectives ont été traitées de façon discriminatoire, au profit de ce qui est désigné comme la white male culture : l’Amérique des hommes blancs de filiation européenne.
De là plusieurs caractères de l’idéologie PC. D’abord, le détour par les « cultures » n’est qu’un habillage nouveau de l’individualisme égalitaire de la démocratie moderne : l’objectif est d’obtenir enfin les conditions d’une vraie égalité des individus devant les carrières que leur offre la société, en les délivrant des handicaps que font éventuellement peser sur eux leurs « cultures ». Par où on retrouve l’égalitarisme hédoniste de la démocratie, avec une panoplie enrichie, puisque la marche à l’égalité ne passe plus par la seule promotion méritocratique des individus tels que la société les fait naître, mais par des techniques sociales de rattrapage collectif au profit des groupes qui ont fait l’objet d’une discrimination négative par suite de l’hégémonie « culturelle » des hommes blancs. L’idée du traitement préférentiel en faveur de l’individu membre d’une minorité opprimée, idée élaborée à propos des Noirs, en fonction du caractère dramatique de leur histoire et de leur situation, cette idée est étendue à toutes les minorités (telles que j’en ai défini le sens plus haut). C’est à la fois un produit et une mutation de la passion égalitaire moderne. Défendue becs et ongles par les activistes PC, et passée dans la législation et à la jurisprudence, elle suscite en sens inverse des hostilités très fortes, dans la mesure où elle est une rupture avec le modèle méritocratique classique, dont les Américains avaient fait comme leur affiche nationale. Dans les raisons cachées – nombreuses – qui opposent souvent Noirs et Juifs dans les Etats-Unis d’aujourd’hui il y a ces conceptions opposées de la promotion sociale des individus. Les Juifs croient à l’école, les Noirs à l’affirmative action.
Une autre conséquence, ou un autre aspect, du « multiculturalisme » militant est la dénonciation de la culture européenne, comme de la source (et de la justification en même temps) de l’hégémonie white male. C’est le côté le plus désolant, sur le plan intellectuel, de cette nouvelle vulgate politique, car il conduit à relativiser toutes les œuvres de l’esprit de l’art, et à ruiner l’idée d’universalité du vrai, sans laquelle la notion même d’éducation perd son sens. Un intellectuel français ne regarde pas sans mélancolie l’usage fait Outre Atlantique de certains de nos grands « gourous » nationaux des années soixante et soixante-dix. Notons d’ailleurs au passage que relativisme culturel est contradictoire avec l’accent mis sur le juridique, le rôle du droit et des cours. Il y a dans le mouvement PC la même incohérence logique que dans l’œuvre de Foucault : comment justifier au nom de Nietzsche un militantisme démocratique d’extrême gauche ? A fortiori si l’on y donne au droit une place centrale. Il entre aussi dans cette négation passionnée de la culture européenne dans les milieux activistes des universités américaines quelque chose du rapport ambigu que les Américains entretiennent depuis l’origine avec l’Europe : un passé qu’ils ont fui, bien qu’ils en soient les fils. Et un avenir dont ils veulent être les explorateurs, pour montrer le chemin au monde qu’ils ont quitté. Il y a de l’utopie sociale dans la political correctness, et un peu de barbarie, comme dans toutes les utopies.
D – Comment s’organise et se gère cette alliance curieuse des féministes et des minorités ethniques, notamment les Noirs ?
F.F. – Les féministes pensent la communauté des femmes sur le modèle d’une « minorité », comme ayant subi au cours des siècles une discrimination négative qu’il faut racheter au nom de l’égalité des droits. De ce fait, elles se pensent comme victimes d’une oppression de même nature que celle qui a pesé sur les Noirs, malgré l’extravagance de cette analogie. Elles réinventent une histoire de l’humanité vue sous cet angle, à partir de la « culture » des femmes, histoire teintée d’une forte hostilité aux mœurs et à la prétention universaliste de l’Europe : par où elle rejoint celle des « Afro-Américains », au prix d’une absurdité. Car il est évident que, globalement, l’histoire non européenne, passée et présente, offre des illustrations d’oppression des femmes infiniment plus criantes que le monde européen. D’ailleurs, la communauté noire américaine – hommes et femmes ensemble – est tout ce qu’on veut, sauf portée au féminisme… Mais comme toutes les idéologies politiques modernes fortes, celle de la political correctness ne se définit pas par rapport à l’observation des faits. Elle part d’une idée de l’humanité qu’elle prétend imposer à tous, à travers le prechi-prêcha militant et les arrêts de justice invoqués comme des textes de philosophie morale. Ce faisant, elle tend à rejeter le pluralisme des opinions et des visions du bien commun qui est à la base de la société moderne. Au nom de l’autonomie absolue des individus et de leur égalité non moins absolue dans la jouissance de cette autonomie, elle menace leur liberté réelle, elle leur dit ce qu’il faut penser et comment il faut agir. Ce n’est pas la première fois, les français sont payés pour le savoir, que l’idée démocratique maniée sans prudence se retourne contre elle-même. Même la patrie de Madison n’est pas à l’abri de ce péril. (…)
Extraits du Débat, numéro 94, daté mars avril 1997
L’enjeu du multiculturalisme
(…). L’Europe, déjà chargée du mal totalitaire, a été frappée en plus de la malédiction coloniale. (…) Il ne faut pas chercher ailleurs, vingt ans après, le secret de l’extraordinaire popularité qu’ont sur les campus américains des livres comme ceux de Franz Fanon ou de Rigoberta Menchù ; bien qu’il s’agisse plus de cris de colère anticolonialistes que d’ouvrages philosophiquement ou historiquement substantiels, ils meublent des multitudes de séminaires consacrés à la critique de l’universalisme européen, sous sa forme judéo-chrétienne ou moderne. Ils forment la pointe avancée d’une dénonciation de dead white European males, formule que je renonce à traduire pour lui laisser l’allure d’imprécation qu’elle possède dans le vocabulaire politically correct : la tradition européenne toute entière, des Grecs jusqu’aux Lumières, est mise en accusation, comme coupable de sexisme (males), de racisme (white) et de passéisme (dead). C’est contre elle que se dresse la coalition bigarrée des vrais émancipateurs de l’humanité contemporaine, les Noirs, les femmes, les « minorités ».
Le « multiculturalisme » est le drapeau de cette coalition hétéroclite. Il peut être pris en deux sens, qui ne sont pas incompatibles. D’un côté, il manifeste l’ambition d’élargir jusqu’aux identités culturelles le mouvement de l’égalité démocratique, de façon à rendre celui-ci, conformément à sa dynamique, chaque jour plus « réel », c’est-à-dire plus conforme au vécu des opprimés. D’un autre côté, l’idée multiculturaliste veut défaire le lien historique qui a uni les peuples modernes au cadre national, si longtemps perçu, en Europe avant tout, comme le vecteur de ce que les hommes des Lumières ont appelé la « civilisation ». Elle veut y substituer une agrégation de groupe humains divers, restés fidèles à leur « culture » et même à leur langue, et vivant pourtant à l’ombre d’institutions communes et sous la protection des mêmes lois. Elle dénie à la nation toute prétention à l’universel – là se nouent les soupçons constants qu’elle nourrit sur la littérature ou la philosophie de l’Europe. Mais, du coup, elle renonce elle aussi à l’universel, qu’elle remplace par un relativisme culturel absolu, présenté comme une grande découverte sur la route du progrès. Les Etats-Unis d’aujourd’hui sont, sur le plan intellectuel, ce pays étrange où le nihilisme « post-moderne » est célébré comme une philosophie de l’émancipation et de l’égalité démocratiques.
Il est vrai que le même mouvement qui les éloigne de l’Europe les rapproche de leur propre expérience historique. Non seulement parce que celle-ci a comporté la fuite hors d’Europe et la lutte contre la métropole anglaise. Mais aussi parce que leur jeune République s’est développée par des apports successifs de deux groupes d’immigrants à la fois homogènes et divers, autorisés à conserver leurs traits culturels dans leur pays d’accueil, qui leur offrait un cadre politique et des lois plus qu’une véritable substance nationale. En Europe, l’Etat est né avec les nations et les rois. Outre Atlantique, il a surgi avec la démocratie et par elle. Si la révolution américaine n’a pas été obsédée par la table rase, comme la France de 1789, c’est qu’elle en a trouvé les conditions dans son berceau. Aux yeux des immigrants qui l’ont peuplée, la République constituée en 1787 a pu figurer depuis lors de cette pure forme politique qui leur offrait à la fois une hospitalité durable et une citoyenneté nouvelle : l’occasion d’une rupture radicale, adoucie par la familiarité maintenue avec les vieux liens d’appartenance. Pendant deux siècles, des « minorités » ethniques se sont installées aux Etats-Unis comme dans leur lieu prédestiné, puisqu’il était – prétendit être – a-national.
Il y a dans le multiculturalisme quelque chose qui ressemble à l’utopie libérale telle que l’a incarnée l’Amérique du XIXème siècle. L’idée évoque cette multitude d’individus venus de partout pour transformer leur condition sur une nouvelle terre, si différents par leurs origines et pourtant si semblables par leurs ambitions. Ils conservent souvent l’attache de leurs communautés, mais la réussite matérielle, rêvée ou réelle, donne un ressort identique à leurs existences. Contrairement à ce qui se passe en Europe, le marché les unit plus qu’il ne les divise, inséparable qu’il est de leurs convictions individualistes et démocratiques. Aujourd’hui, le « multiculturalisme » n’est que la figure la plus récente de cette unité. Née de la volonté d’intégrer enfin dans la République les Noirs, ces grands exclus de l’American dream, l’idée s’est progressivement étendue à toutes les « minorités » (sauf aux juifs, pour une fois privés de leur titre historique au malheur), et elle s’est imposée par la puissance du mouvement féministe. C’est la version américaine de la marche à l’égalité « réelle » par opposition à l’égalité formelle ». Elle est dans son fond plus individualiste que communautaire et traduit, de ce fait, malgré les apparences, la tendance à l’uniformité de la démocratie. Everybody is different veut en réalité dire everybody is the same.
Si cette analyse est exacte, elle donne au multiculturalisme un éclairage nouveau : la tentative d’inventer un nouvel universalisme à l’américaine, contre la tradition européenne. L’idée est intellectuellement incohérente, puisque l’universel démocratique est un produit de la pensée européenne, y compris dans la version qu’en a présentée la fondation des Etats-Unis. Et c’est aussi l’Europe qui a inventé l’anthropologie et l’unité de l’homme dans la multiplicité de ses cultures. L’entreprise est absurde, qui prétend penser l’universel sans Montaigne ou sans Kant, a fortiori contre eux, et c’est d’ailleurs ce qui la condamne au nihilisme (enfant lui aussi de l’Europe, mais d’un retournement de la pensée européenne contre elle-même). Pourtant, l’utilisation paradoxale d’une philosophie pessimiste en idéologie du progrès social montre que faute de solidité intellectuelle, le relativisme multiculturaliste possède une large assise politique dans le monde d’aujourd’hui : celle que lui offre l’American dream à l’heure de son triomphe planétaire.
A l’intérieur des Etats-Unis, les voix critiques sont rares. Dans le monde académique, elles viennent surtout de l’école straussienne, adossée à l’étude des classiques grecs et de la tradition occidentale. Allan Bloom en a été l’interprète le plus talentueux et le plus connu, mais le succès même de son livre dans le public a accentué son isolement dans le monde intellectuel. A force de remplacer des juifs allemands par des féministes, les universités américaines courent le risque d’être infidèles à leur glorieuse période d’après la guerre, pour n’être plus que les cathédrales du nouveau gospel. Dans l’opinion, le môle de résistance est fourni par l’Amérique chrétienne, hostile à l’avortement et plus encore à la célébration des minorités homosexuelles : vaste électorat bourgeois rassemblé autour des prédicateurs trop exagérés pour n’être pas un peu philistins ; monde trop réactionnaire, au sens propre du mot, pour peser vraiment même sur le parti républicain (…).
François Furet