Dans son livre Rue Jean-Pierre Timbaud paru au printemps 2016, Géraldine Smith raconte une vie de famille dans un quartier de Paris qui, par la confrontation de populations très différentes, « bobos et barbus » comme dit son sous-titre, nous semble révélateur d’une certaine France d’aujourd’hui. La forme de son récit est par ailleurs très intéressante : sans prétentions sociologiques ou politiques, elle part de ses souvenirs, parents et enfants dans les écoles, amitiés, antipathies, espaces publics et privés….toute la politique de la vie quotidienne.
Il semble que les débats qui ont suivi la publication de Rue Jean-Pierre Timbaud aient parfois eu du mal à rendre compte de tant de complexités, et c’est pour cela que nous avons voulu poser à Géraldine Smith, qui réside maintenant aux Etats-Unis, ces quelques questions provoquées par un livre perspicace, courageux, original. Ndlr
Propos recueillis pour Contreligne par Alice Kaplan
Alice Kaplan – Pourquoi cette envie d’écrire sur ce sujet, et sur le mode autobiographique ?
Géraldine Smith – A l’origine de ce projet, il y a mon incompréhension et ma déception face à un échec personnel. En 1995, quand commence le récit, je suis journaliste, spécialiste de l’Afrique où j’ai vécu plusieurs années. Stephen, mon mari américain, qui est également journaliste, a longtemps vécu au sud du Sahara et continue alors de couvrir l’Afrique depuis Paris. Il est à l’époque le responsable des pages Afrique de Libération, un quotidien de gauche. Quand nous nous installons en famille dans un petit coin de Belleville populaire et très mélangé, socialement et ethniquement, nous sommes convaincus d’avoir trouvé un lieu qui nous ressemble. Rue Jean-Pierre Timbaud, en face de l’ancien siège du syndicat de la métallurgie, l’école catholique est mitoyenne d’une mosquée et d’un centre juif pour enfants handicapés. Ce télescopage me fascine. Il me semble refléter l’image d’une France que j’appelle de mes vœux. Or, dix ans plus tard, je quitte le quartier sans regrets. Plusieurs de nos amis, comme nous désabusés, déménagent aussi. Que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui n’a pas marché ? C’est le sujet de mon livre.
J’ai commencé à l’écrire comme un reportage. Mais je me suis rendue compte que l’exposé des faits, sans implication, ne traduisait ni mes émotions, ni mes erreurs. Plus grave, deux ex machina de mon histoire, j’avais tendance à réinterpréter les événement avec le bénéfice du recul. Le résultat était une narration « édifiante » là où je voulais traquer mon malaise. J’ai alors décidé – ça m’a coûté ! – d’écrire comme « la mère de famille » que j’étais aussi, c’est-à-dire au raz du quotidien, dans mon corps-à-corps avec une réalité souvent frustrante, rarement glorieuse. Décrire ma colère après un goûter d’anniversaire qui tourne au fiasco, mon impuissance face à un père de famille algérien au chômage qui désespère de « sauver ses enfants de la racaille », c’est ma façon de dire – j’y vais tout droit – qu’il est plus facile de défendre l’ouverture totale des frontières lors d’un dîner dans le Ve arrondissement que de scolariser ses enfants dans un lycée public du XXe.
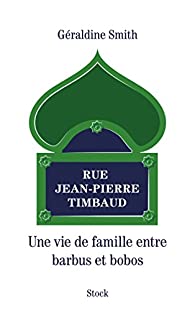
Votre connaissance de l’Afrique vous a-t-elle donné une sensibilité particulière à la vie quotidienne de la rue Jean-Pierre-Timbaud ?
Grâce à l’Afrique, il n’y avait aucun risque que je confonde l’islam et l’islamisme, un hijab et une burqa, un croyant et un djihadiste. J’étais aussi moins intimidée à l’idée de me faire taxer de raciste ou d’islamophobe. Au début des années 90, j’avais vécu à Dakar dans un studio que me louait un chef traditionnel Lébou, qui était musulman comme la quasi-totalité des Sénégalais. Ma pièce donnait sur sa cour intérieure, qui se remplissait de fidèles au rythme des appels du muezzin. Il m’invitait à boire le thé, nous nous entendions bien. Il est le premier à m’avoir parlé d’une « menace fondamentaliste » dans un pays pourtant pourtant dominé, sur le plan religieux, par les confréries soufies. Sous l’influence de prédicateurs étrangers officiant dans des mosquées souvent bâties avec des fonds saoudiens, le salafisme se développait à cette époque au Sénégal. On voyait au marché les premières femmes portant le voile intégral, des prêcheurs commençaient à s’en prendre à un soufisme jugé trop mou. L’islamisme, l’instrumentalisation de la foi musulmane à des fins politiques, est un problème en Afrique comme à Paris.
J’ajoute qu’il est plus facile de comprendre que l’intégration n’est pas un lit de roses quand on est soi-même immigrée – immigrée de luxe, certes, mais immigrée quand même – comme c’est mon cas aux États-Unis. Je m’accroche comme d’autres à ma langue, ma culture, mes habitudes, mes préjugés… Au quotidien, je négocie pied à pied ce qui est « à prendre ou à laisser » dans les deux mondes que je dois réconcilier : ça va de la nourriture au respect dû aux parents en passant par la longueur des jupes… Je n’ai jamais laissé ma fille porter ces shorts ultra-courts et moulants qui sont pourtant la règle aux États-Unis. Mais, venant d’un pays laïque (allez expliquer ce que ça veut dire en cinq minutes !), j’ai pourtant accepté que dieu se glisse dans le contrat social tous les matins quand nos enfants prêtaient allégeance avant de commencer leur journée à l’école publique. Bref, on apprend à faire la part du feu au jour le jour.
J’aime beaucoup la formule de votre fils Max : « Papa, je ne sais pas ce qu’ils ont tout d’un coup : ils se prennent tous pour leur origine. » (p. 122) Là, il s’agit de disputes en classe autour du foot, du petit Kader qui se sent obligé de soutenir l’équipe marocaine et de se désolidariser du PSG. Voilà ce qu’on appelle, dans le contexte américain, « identity politics »… Je voudrais savoir si Max a connu la même situation depuis, aux Etats-Unis.
Il a vécu une variation sur le même thème : quand nous nous sommes installés en Caroline du Nord, en 2007, il a découvert qu’on pouvait même revendiquer des origines très lointaines dans le temps. Le premier jour d’école, à la cantine, il y avait des tablées séparées d’enfants noirs, asiatiques, latinos et blancs. Il n’avait jamais connu ça à Belleville. Ne parlant pas bien l’anglais, vulnérable, il s’est assis chez les Noirs, qui l’ont accueilli plutôt sympathiquement. Plus tard, un copain noir lui a expliqué : « On t’aime bien. T’es pas Blanc, t’es Français ». Autant dire qu’il reste du chemin à faire… Aux États-Unis, l’assignation raciale prime sur tout. Plus qu’évidente, elle passe pour « naturelle » alors qu’elle est tout sauf cela. Il n’y pas de « Latino » en dehors des Etats-Unis, aucun rapport entre un Camerounais francophone et un Noir américain, beaucoup de Noirs américains seraient ailleurs vu comme Blancs et, summum de tout, les « Caucasiens » doivent leur nom à un professeur allemand au 18ème siècle, Johann Friedrich Blumenbach, qui a défini une « race » à partir d’un seul crâne qu’il trouvait merveilleux !
Certains amis de Max ou de Lily sont dans des clubs ouvertement « racialisés », comme Men of Color ou Mixed Race Coalition. J’ai du mal à comprendre de tels choix, qui enferment l’individu dans un seul groupe, une seule facette de son identité. En France, une communauté fondée sur la couleur de la peau est a priori suspecte. Le Conseil représentatif des associations noires, créé en 2005, peine à exister. Les musulmans français sont très peu « communautarisés ». L’idéal républicain français prétend gommer toutes les différences au nom de la fraternité. Y parvient-il dans les faits ? Non, pas plus que le « rêve américain » n’assure l’égalité des chances aux États-Unis. Mais maintenant qu’on n’y croit plus, en France, cet idéal républicain d’assimilation passe pour un leurre, une « arnaque » dont le but réel viserait à faire de tous un « Français moyen » qu’on devine blanc, catholique, amateur de vin et de bonnes chères, vaguement grivois. Bien sûr, ça ne passe plus. Pourquoi serait-on moins « français » parce que l’on est noir ou musulman ? Que signifie « être français » ? Pour moi, en attendant de trouver mieux comme contrat social, est Français qui a la nationalité française. À mes yeux, il n’y ni « Français de souche » ni « Français issu de l’immigration ». Puisque la citoyenneté fait la différence entre eux, on est soit immigré soit Français étant entendu que le passage d’un statut à l’autre est balisé de droits et d’obligations s’imposant à tous.
La question de l’origine est différente de celle de la race, un concept qui n’a d’ailleurs aucun fondement scientifique. Aux Etats-Unis, on est fiers de ses origines italienne, irlandais, africaine… En France, dire d’un jeune né en France qu’il est Franco-Algérien ou Franco-Camerounais, c’est le stigmatiser, en faire un citoyen de seconde zone. Qui a raison ? Quand le jeune Kader, dans le livre, me dit qu’il est Franco-Marocain et fier de l’être parce que bien incapable de choisir entre les deux pays, je ne vois pas où est le problème. Il passe ses vacances au Maroc, il parle marocain, il appartient à deux nations et cultures, comme mes propres enfants qui sont franco-américains (et à qui personne n’intime l’ordre de choisir). En revanche, quand la maîtresse oblige Séverin à parler du Cameroun, où il n’a jamais mis les pieds, seulement parce qu’il est noir et son père un immigré camerounais, elle lui assigne une identité qui n’est pas la sienne.
Rue Jean-Pierre Timbaud, des populations différentes les unes des autres se confrontent dans la rue sans jamais vraiment se fréquenter.
En fait, ils ne se confrontent pas, ils s’évitent. Rue Jean-Pierre Timbaud, bobos, barbus, Loubavitch, Polonais, Nord-Africains, artistes et dealers, jeunes et vieux se côtoient sans se rencontrer… Il y a même quelques personnes fortunées, dans des lofts discrets dans les arrière-cours. Mais les uns et les autres ne se connaissent pas, ou mal, il n’y guère de convivialité. Dans mon livre, Malika se fâche lorsque je lui vante mixité sociale de la rue telle que je la perçois au début. Là où un bobo voit un bar sympa, elle voit du bruit et le vomi qu’il faut enjamber sur les trottoirs le matin. Et cette mosquée « qui ne gêne personne », elle la voit comme le lieu qui aspire son fils aîné dans un vortex de radicalisation. Les bobos ont leurs restaurants, leurs boutiques, leurs boulangeries, leurs dérogations à la carte scolaire. Dans le fond, ce qui me dérange, ce n’est pas leur mode de vie, qui est en partie le mien. Ce qui me gêne, c’est que la tolérance est devenue le masque de l’indifférence que portent les uns aux autres. On se prétend ouvert mais, en réalité, on se recroqueville dans son alvéole, quitte à abandonner la place publique aux islamistes, les seuls à avoir encore un projet collectif.

On découvre, dans votre livre, une géographie parisienne fortement ségréguée. Beaucoup de camarades de classe de vos enfants, et même leurs parents, n’ont jamais traversé la Seine : l’excursion au jardin du Luxembourg se déroule comme une visite dans un autre pays.
Je crains qu’il y ait dans beaucoup de capitales du monde de telles frontières invisibles. À Paris, historiquement, les quartiers de la rive gauche et à l’Ouest ont été urbanisés le plus tardivement et certains villages, comme Monceau, n’ont été annexés que dans la seconde moitié du 19ème siècle. Plus récemment, la fréquentation de l’espace public a évolué avec l’apparition du RER, le métro de la grande banlieue : les Champs-Elysées, en haut desquels se trouve la station Charles de Gaulle, ou le Forum des Halles, ont ainsi été abandonnés par les « vrais » Parisiens aux « gens des cités », en plus des touristes. Tout cela pour dire qu’en effet, on ne croise pas beaucoup d’ouvriers boulevard Saint-Germain, ni de Noirs dans les jardins du Luxembourg. Que les enfants – nés à Paris – du boulanger de Ménilmontant ne soient jamais montés dans la tour Eiffel, ou que l’un de mes amis d’une grande famille bourgeoise n’ait jamais « passé le périph’» en dit effectivement long sur le cloisonnement social. C’est aussi une question de moyens : au café de Flore, le « petit noir » est à 4,60 euros, alors qu’on boit son expresso pour moins de 2 euros à Belleville.
La scène du « convoi vers la rive gauche » est l’un des moments forts de votre livre. Arrivant au Théâtre des Marionnettes, on sent le doux souffle de l’universalisme : tous les enfants sont impliqués comme spectateurs. Puis Djed déconne, sa mère hurle. Et le gardien du parc lance, « On n’est pas au souk ici. » Vous avez alors honte de lui dans « votre » jardin du Luxembourg. Nous, lecteurs, sommes gênés par votre honte, puis nous y identifions. Vous dites que la reconnaissance de son propre racisme peut être une aubaine, pourrait nous avancer. Reconnaître son propre racisme, son propre sexisme, comment cela marcherait-il ?
Il ne s’agit pas de racisme. Ce jour là, j’ai honte, l’espace de quelques instants, d’être avec une femme qui hurle en arabe dans les jardins du Luxembourg. Puis, j’ai honte d’avoir honte d’elle et de son enfant. Cela ne fait pas de moi une raciste. Dans le fond, ce qui me gêne à ce moment là, ce n’est pas de me promener dans Paris avec une femme voilée (je viens de passer la journée avec elle), ce qui me gêne c’est qu’elle hurle dans un espace public dont je connais et partage les codes : au Luxembourg, on ne hurle pas… Si elle avait hurlé au Parc de Belleville, je n’y aurai même pas prêté attention. J’ai donc une réaction qui traduit notre différence sociale : ce n’est guère mieux, mais cela n’a rien à voir avec du racisme. Je lui en veux mais pas pour son origine. Je lui en veux parce qu’elle vient de faire éclater ma bulle de rêve. Je m’étais grisé de cette belle journée, des rires devant Guignol, j’avais regardé les gamins et je m’y étais cru, dans cette France cosmopolite de toutes les couleurs. Or, l’incident entre le gardien et la mère de Djed me ramène à la réalité. L’atterrissage est brutal.
Je n’exclue pas avoir eu, en d’autres circonstances, un premier réflexe raciste. Par exemple, un Chinois crache dans le métro et je pense in petto: « Y’en a marre de tous ces Chinois qui crachent partout ! ». À mon avis, si l’on veut surmonter le racisme, il faut cesser de le présenter comme un sentiment extraterrestre, quelque chose qui n’arrive qu’aux autres. C’est pour cela que je rapporte dans le livre l’anecdote de Nelson Mandela qui, à peine sorti de 27 ans de prison, monte dans un avion, se rend compte que le pilote est noir et, par réflexe, se dit : « pas de chance ! ». Mandela en parle dans son autobiographie pour mettre en exergue la « banalité du mal », comme dirait Hannah Arendt. Si on avait tous ce courage, on pourrait accomplir un travail collectif pour aller à rebours de nos préjugés. On ne vaincra pas le racisme en mettant des procureurs généraux à tous les coins de rue, ou par auto-flagellation.
Qu’est-ce que l’aspect autobiographique par lequel vous avez abordé votre sujet vous a permis de voir ou de faire que les spécialistes de l’islam comme Gilles Kepel ou Olivier Roy ne voient pas ?
J’apprécie et Gilles Kepel et Olivier Roy, je les lis depuis mes années d’étudiante en sciences politiques. Ils ont chacun leur grille de lecture et enrichissent notre compréhension de l’islam en France. Ils en ont fait leur métier. Moi, non. Je chronique mon expérience quotidienne de mère et de femme sur vingt ans dans une rue de Paris, quelques centaines de mètres. Bien sûr, je pense que mes observations peuvent recouper d’autres réalités ailleurs en France. Mais je ne sors pas de mon « terrain ». Je laisse aux lecteurs le soin d’établir des parallèles ou de relever des contradictions, en un mot : de faire le travail de la généralisation, là où cela a un sens. Pour le meilleur et pour le pire, je les invite à partager mon vécu – et non pas une analyse. Je n’ai pas de magistère mais la liberté d’exprimer ma subjectivité. On s’y retrouve ou pas, dans les deux cas, mon récit ouvre un débat qui est différent du débat habituel autour du « malaise social » en France. Je donne à ce malaise une adresse postale, le visage de quelques dizaines de témoins, un cadre et des circonstances précis. Cela change la conversation.
Que dire de la réception de votre livre ? Comment la jugez-vous ? Sentiez-vous de la réticence de la part des journalistes ou, au contraire, de l’intérêt ?
Des comptes rendus positifs et des interviews sont parues dans la presse de gauche comme de droite, du Figaro au Monde, de Marianne aux Inrockuptibles. On m’avait prédit le pire, que je devais me préparer à être violemment prise à partie mais rien de cela n’est arrivé. Cependant, une rencontre-débat dans une librairie près de la rue Jean-Pierre Timbaud a été annulée à a suite de menaces émanant d’abord de bobos, puis d’islamistes. Et les réactions des internautes sous les recensions ou les interviews sont souvent violentes. A droite, pour certains, je suis une « bobo repentie qui s’aveugle encore ». On devine que les gens qui « commentent » n’ont pas lu le livre, mais y trouvent quand même la preuve, s’il leur en fallait une, que l’islam est incompatible avec la France. A gauche, pour d’autres, je raconte n’importe quoi en « faisant passer le quartier pour une no-go zone alors que tout y est si cool ». Mais, dans l’ensemble, je suis agréablement surprise par l’espace qui est désormais ouvert en France pour débattre sans ambages de notre « vivre ensemble » en panne.

J’ai le sentiment que la France est plus mélangée que les États-Unis. Notre mouvement américain des droits civiques déclenché dans les années 60 a-t-il échoué ?
Je n’ai pas d’expertise pour juger du succès du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis mais, s’il visait l’émancipation plutôt que le « mélange », une notion assez confuse, un bon bout de chemin a été accompli. En l’absence de statistiques ethniques officielles, qui sont interdites en France, la comparaison entre les deux pays est difficile.
À vue de nez, il me semble effectivement que les villes françaises demeurent, malgré une communautarisation tardive mais croissante, plus mélangées, ethniquement et socialement, que les villes américaines. En revanche, les minorités sont bien plus visibles en Amérique qu’en France (un incontestable acquis de la lutte pour les droits civiques). Pour ne citer que cet exemple, on comptabilise 10 députés « issus de la diversité » sur 577 élus au parlement français. On est loin d’un « caucus » de poids !
A lire
Rue Jean-Pierre-Timbaud. Une vie de famille entre barbus et bobos, de Géraldine Smith. Stock, 194 pages, 18,50 euros.